(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Vidéos
Infractions de presse (Janvier 2019 - Décembre 2019)
2019 restera comme une année trouble marquée par la recrudescence des tensions sociales. La liberté d'expression a été largement mise à mal, comme en témoignent les tentatives récurrentes et plus ou moins déguisées de bâillonnement de l'information : interpellations de journalistes, perquisition au sein d'entreprise de presse, création d'un « conseil de l'ordre des journalistes » et convocations par le procureur de la République de journalistes pour compromission du secret-défense. La force et la spécificité de la loi sur la presse ainsi que la compétence exclusive du tribunal pour juger ce qui relève du caractère d'intérêt général de l'information doivent être réaffirmées et protégées contre les tentatives de contournements portant atteinte à la liberté d'informer le public sur des sujets d'intérêt général.
I - Le périmètre de la loi du 29 juillet 1881
A - La loi de 1881 et la norme constitutionnelle
Les nombreuses QPC portant sur la loi de 1881 se font l'écho des attaques législatives et gouvernementales dont la loi est l'objet. La Cour de cassation joue néanmoins son rôle de filtre et rejette souvent ces questions, soit au titre de la recevabilité, soit pour absence de caractère sérieux. Il en va ainsi de cette première décision, qui réaffirme l'importance de ce régime dérogatoire à la fois « libéral et équilibré, auquel il ne doit être touché que d'une main tremblante »(1).
La QPC objet de la décision du 7 mai 2019 portait sur la présomption d'imputabilité en matière de diffamation, dégagée de façon prétorienne de l'article 29, alinéa 1er, de la loi de 1881. Selon la jurisprudence, les imputations diffamatoires sont ainsi réputées faites « avec l'intention de nuire ». Le requérant voyait dans cette présomption une atteinte aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 9 ainsi qu'à l'article 11 du même texte.
La Haute assemblée rejette la QPC en relevant que « la présomption d'imputabilité au titre de l'élément moral du délit de diffamation à l'auteur des propos incriminés, qui est inhérente aux dispositions en cause, est dépourvue de tout caractère irréfragable, le prévenu ayant la faculté de démontrer, soit la vérité du fait diffamatoire, selon les modalités prévues par les articles 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, soit l'existence de circonstances particulières de nature à le faire bénéficier de la bonne foi ; qu'elle ne fait pas obstacle à l'exercice des droits de la défense ». Elle réaffirme ainsi l'équilibre instauré par ce texte d'exception : si le principe de présomption de culpabilité n'apparaît pas contraire à la Constitution, c'est précisément en raison des faits justificatifs instaurés par la loi et découverts par la jurisprudence, qui rendent la présomption parfaitement réfragable, tout en maintenant l'équilibre entre les parties (Crim. 7 mai 2019, no 19-81.627)(2).
D'autres décisions ont en revanche été transmises au Conseil constitutionnel en 2019. On ne reviendra pas sur la décision ayant abrogé la référence aux regrettés myriamètres, déjà commentée dans ces pages(3).
On prendra en revanche le temps de s'arrêter sur une décision du Conseil du 6 décembre 2019. Ce dernier était saisi par l'hebdomadaire Paris Match d'une QPC portant sur l'article 38 ter de la loi de 1881, interdisant l'enregistrement d'images ou de paroles lors des audiences. Le Conseil écarte le grief tiré d'une atteinte disproportionnée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relevant que l'atteinte « qui résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis », à savoir la bonne administration de la justice, la sécurité des acteurs judiciaires, la protection de la présomption d'innocence et le droit à la vie privée. Le Conseil précise ensuite que la captation et l'enregistrement des audiences, sur lesquels porte l'interdiction, « ne perturbent pas en eux-mêmes » nécessairement le déroulement des débats. En revanche, leur diffusion présente un risque, amplifié par « l'évolution des moyens de communication », « susceptible de conférer à cette diffusion un retentissement important ». Mais il ajoute également que l'interdiction ne prive toutefois pas le public « de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement, sous réserve du pouvoir de police du président de la formation de jugement ».
Le Conseil semble donc tout à la fois vouloir surtout prévenir un risque de personnalisation et d'identification des magistrats tout en reconnaissant explicitement le droit des journalistes et du public de live-tweeter les audiences ! (Cons. const. 6 déc. 2019, no 2019-817 QPC)(4).
B - La loi de 1881 et le code civil
La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà, en 2018, rejeté un pourvoi de la société Bolloré qui s'estimait atteinte par des propos diffamatoires visant en réalité son président(5). Dans une nouvelle procédure visant un reportage diffusé par France Télévision en 2016, « Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien ? », la société tentait sur le terrain du dénigrement (C. civ., art. 1240) de contourner l'application des garanties procédurales protectrices de la loi sur la presse.
Mais la Cour d’appel de Paris ne s'y est pas laissée prendre et a confirmé le jugement d'incompétence du tribunal de commerce, d'autant que la société avait par ailleurs engagé d'autres procédures concernant le même reportage et fondées, elles, sur la loi de 1881. Elle juge qu'« une publication de presse, dont l'enquête est le préalable indissociable, même si elle porte sur un sujet économique et vise une société commerciale, ne peut faire l'objet d'une action judiciaire fondée sur la responsabilité civile de droit commun, sauf en cas d'informations dénigrantes sur des produits ou services ». En l'espèce, le reportage en cause, selon les magistrats, ne comportait aucune analyse critique de produits ou services du groupe.
La société a en outre été condamnée pour procédure abusive au regard du contexte procédural général de l'affaire. Elle a été également condamnée pour procédure abusive et abus de constitution de partie civile dans deux autres affaires cette année. Ce qui ne l'a pas dissuadée de se pourvoir en cassation dans la présente affaire et de faire appel dans une autre(6) (Paris, pôle 2 - ch. 7, 27 mars 2019, n° 18/15647, SA Bolloré c/ SA France Télévisions ; dans le même sens, une seconde action en dénigrement menée contre des journalistes auteurs d'un autre documentaire TGI Paris, 17e ch. civ., 6 mars 2019, SA Vivendi c/ N. Vescovacci)(7).
Par ailleurs, s'agissant du dénigrement visant non pas des produits ou services mais une profession, la 17e chambre du Tribunal de grande instance de Paris a eu l'occasion de spécifier que « les propos visant un groupe de professionnels ou une catégorie professionnelle déterminée » peuvent être qualifiés de dénigrants « à la condition que soit alors constatée l'existence de manquements particulièrement graves ou de fautes intentionnelles ». Bien que le dénigrement ne relève pas de la loi de 1881, il n'en reste pas moins qu'il est susceptible de constituer « une restriction au principe fondamental de la liberté d'expression ». Aussi, la responsabilité civile de l'auteur des propos doit s'apprécier strictement. « Lorsque l'information se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d'expression » (TGI Paris, 17e ch. civ., 20 févr. 2019, Association française de chiropraxie c/ Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes)(8).
Enfin, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser dans une décision du 12 septembre 2019 que la publication par erreur de la photographie d'un homme, pour illustrer un article consacré à un individu soupçonné de terrorisme, ne saurait s'analyser comme une diffamation régie par les dispositions de la loi de 1881, mais comme une atteinte au droit à l'image, dont la réparation doit être recherchée sur le fondement de l'article 9 du code civil (Civ. 1re, 12 sept. 2019, no 18-23.108)(9).
C - Premier référé « fake news »
La première décision rendue sur le fondement du nouvel article L. 163-2 du code électoral, introduit par la loi no 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, dite « fake news », a été l'occasion pour les juges de rappeler les conditions prévues par le texte. Rendue à l'aune de la décision du Conseil constitutionnel comme des travaux parlementaires, c'est également une belle leçon d'exégèse.
Les juges ont en effet rejeté la demande de retrait du tweet litigieux, publié par le ministère de l'Intérieur et portant sur la prétendue invasion violente de la Pitié Salpêtrière lors des manifestations du 1er mai dernier. Ils auraient pu se contenter de souligner l'absence de diffusion automatisée du message, suffisant à elle seule pour rejeter la demande. Mais ils ont profité de cette affaire pour préciser les conditions tenant au caractère inexact ou trompeur de l'allégation et au risque d'altération de la sincérité du scrutin. En l'espèce, si le tweet litigieux apparaît exagéré, il porte sur des faits réels, à savoir l'intrusion de manifestants dans l'enceinte de l'hôpital. Une simple exagération ne constitue par une information « manifestement » inexacte ou trompeuse, d'autant que les faits, relève le tribunal, font l'objet d'une procédure judiciaire.
Par ailleurs, il relève que le tweet n'a pas occulté le débat public et ne risque donc pas d'altérer la sincérité d'un scrutin, puisqu'il a été immédiatement contesté par de nombreux articles de presse écrite ou en ligne, « permettant ainsi à chaque électeur de se faire une opinion éclairée, sans risque manifeste de manipulation ». Comme l'ont souligné certains commentaires, cette première décision n'est certainement pas de nature à rassurer ses détracteurs quant à l'utilité d'un tel texte, compte tenu du corpus juridique existant (TGI Paris, 17 mai 2019, n° 19/53935, Mme Vieu & M. Ouzoulias c/ Twitter France).
II - Caractéristiques communes aux différentes infractions de presse
A - Publicité des propos
1 - Notion de « communauté d'intérêts »
La Cour d’appel de Paris a confirmé dans un arrêt non définitif du 19 décembre 2019, la condamnation pour injure publique de la présidente du Syndicat national de la magistrature dans l'affaire dite du « Mur des cons ». Celle-ci avait défrayé la chronique en 2013, lorsqu'un journaliste avait filmé et révélé ce collage de photos de personnalités publiques, installé dans les locaux du Syndicat de la magistrature.
L'élément de publicité de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 y était notamment discuté. S'agissant d'un affichage, la publication est réalisée par l'exposition au regard du public. La seule présence d'un destinataire extérieur est susceptible d'établir la publicité du propos, si l'exposition a été accomplie avec la conscience que le propos ou le support serait effectivement entendu ou vu par des tiers. C'était bien le cas en l'espèce, dès lors que diverses personnes extérieures au Syndicat de la magistrature sont entrées dans le local syndical, avec l'accord des représentants du syndicat et que la magistrate a accompagné le journaliste devant le « Mur des cons » et parlé avec lui de son contenu (Paris, pôle 2 - ch. 7, 19 déc. 2019, n° 19/01374, F. Martres c/ Philippe S. et a.).
La Cour d'appel d'Aix juge que les propos en langue régionale, tenus sur un blog spécialisé et dans le cadre d'échanges sur un sujet en lien avec ladite langue, établissent l'existence d'une communauté d'intérêts et justifie la requalification en diffamation non publique. La doctrine s'est interrogée sur cette décision, le critère de la langue employée étant absent de la loi de 1881, même s'il nous semble qu'il s'agit bien du nombre de personnes susceptibles de comprendre le message diffusé (Aix-en-Provence, ch. corr., 1er oct. 2018, n° 18/00674, Alain X. c/ Dominique Y.). On soulignera que dans une autre espèce relative à un cas de diffamation en langue des signes, la problématique de la « publicité » n'a pas été soulevée (Paris, pôle 2 - ch. 7, 25 sept. 2019, n° 17/15411, Mme R. L. c/ O. M.).
2 - Nouvelle diffusion et liens hypertextes
Dans son jugement du 26 juin 2019, la 17e chambre du Tribunal de grande instance de Paris fait application de la jurisprudence selon laquelle l'insertion d'un lien hypertexte renvoyant directement à un écrit diffamatoire précédemment publié, caractérise une nouvelle publication dès lors qu'il s'inscrit dans un « contexte éditorial nouveau ». Elle précise que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme commande de vérifier les circonstances de mise en ligne de ce lien, en examinant notamment si l'auteur du lien hypertexte s'est approprié ou distancié du contenu auquel il renvoie (TGI Paris, 28 juin 2019, J.-M. Cox c/ Guillaume de T.).
B - Une personne, un corps ou un groupe, identifié ou identifiable
1 - Le respect dû à certains corps et professions : articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881
Les infractions de presse font l'objet d'une sanction plus ou moins sévère en raison de la qualité ou des fonctions de la ou des personnes visées. Les infractions commises envers les « personnes publiques » relèvent de l'article 31, alinéa 1er, qui punit la diffamation commise envers les personnes revêtues des qualités qu'il énumère. Les infractions envers « les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques » relèvent quant à elles de l'article 30.
S'agissant des « corps constitués » de l'article 30, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que ne peuvent agir en diffamation sur ce fondement que les corps constitués ayant une existence légale permanente, auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de l'autorité ou de l'administration publique. Cette définition ne s'applique pas au Conseil de l'Ordre des experts-comptables (Crim. 18 juin 2019, n° 19-80.088).
S'agissant des « personnes publiques » de l'article 31, la Cour de cassation rappelle que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, est reconnue à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas de l'organe exécutif de l'Institut de France. Celui-ci présente les caractères d'un établissement public administratif et le chancelier, organe exécutif de l'Institut, est dépositaire de l'autorité publique au sens de l'article 31 de la loi sur la liberté de la presse (Crim. 19 févr. 2019, n° 17-85.114 FS-D).
Mais encore faut-il que la diffamation soit commise, d'après l'article 31, alinéa 1er « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité ». En effet, ces diffamations doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent et contenir la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire. Les propos imputant à la partie civile, par voie d'insinuation, le fait d'avoir des tendances pédophiles ne relèvent ainsi pas de l'article 31, celles-ci étant étrangères à ses fonctions ou à sa qualité (Crim. 9 avr. 2019, n° 18-82.753 F-D).
Aussi, lorsque les propos contiennent plusieurs imputations indivisibles, dont certaines seulement mettent en cause la qualité protégée de l'intéressé, l'auteur des propos doit être poursuivi sur le seul fondement de cette qualification plus sévère. La Haute juridiction approuve la Cour d’appel de Paris, qui avait considéré que les propos portant sur l'« exfiltration » d'un magistrat français en détachement à Monaco, le visent en sa qualité de magistrat français « en ce que sa réintégration relève de la compétence de l'État français » et que l'imputation est indivisible de celle mentionnant des « affaires embarrassantes ». L'auteur des propos devait bien être poursuivi sur le fondement de l'article 31. L'arrêt est en revanche cassé en ce qu'il a refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi (Crim. 26 nov. 2019, n° 18-86.335 F-D).
Enfin, dans la lignée des nombreuses QPC déposées l'année dernière et rappelées dans ces pages, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation confirme qu'un État s'estimant victime d'une diffamation ne peut agir en réparation sur ce fondement, sans pour autant que soit méconnu l'accès au juge (Cass., ass. plén., 10 mai 2019, nos 17-84.509, 17-84.511 et 18-82.737 P+B+R+I).
2 - La lutte contre la haine et les discriminations
La loi sur la presse prévoit également des causes d'aggravation lorsque les infractions présentent un caractère discriminatoire. Il est possible de les regrouper en deux grandes catégories : les injures et diffamations commises à raison de l'origine ou de la religion et celles commises à raison du genre ou l'orientation sexuelle de la personne ou du groupe visé. Dans les deux cas, la jurisprudence se cristallise nettement autour des enjeux de définition du groupe visé.
Jean-Marie Le Pen a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur race ou de leur religion, pour avoir déclaré, lors d'une interview sur la radio RTL, que « 90 % des faits divers ont à leur origine soit un immigré soit une personne d'origine immigrée ». Le tribunal énonce que les propos litigieux ont été tenus dans le cadre d'une interview évoquant l'immigration, et faisaient référence aux personnes « immigrées » ou « d'origine immigrée ». Le tribunal juge que les personnes ainsi visées ne constituent pas un groupe au sens de l'article 32, alinéa 2, ces personnes pouvant être françaises et n'ayant donc pas pour point commun leur non-appartenance à la nation française. Il s'ensuit que l'infraction n'est pas constituée. Le prévenu est relaxé (TGI Paris, 17e ch. corr., 13 déc. 2019, SOS Racisme c/ J-M. Le Pen).
Un conseiller municipal de la ville de Saint-Nazaire a mis en ligne sur internet un article intitulé « L'inquiétant sacrifice de l'Aïd el-Kébir au cœur d'un gymnase nazairien ». La Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir condamné le prévenu, alors que les propos poursuivis ne visaient que les particuliers qui auraient participé dans ce gymnase aux faits relatés et non la communauté musulmane dans son ensemble, ni un groupe de personnes en raison de son appartenance à la religion musulmane. En effet, celle-ci ne saurait être réduite au seul exercice d'une pratique religieuse. La cassation est prononcée sans renvoi (Crim. 15 oct. 2019, n° 19-81.631 F-D).
Le propos « C'est le racisme des Juifs qui les a conduits au monothéisme quand ils ont privé de leurs dieux les “Goyim” qu'ils haïssaient », apprécié dans son contexte, n'est pas injurieux à l'égard des personnes juives. D'après les juges du fond, ces propos s'inséraient dans un ensemble intitulé « Comprendre le judaïsme antique en 10 points » et ne rejaillissaient donc pas sur l'ensemble des personnes de confession juive. La Cour de cassation confirme cette analyse et énonce que le propos, pour contestable qu'il puisse être, n'est ni outrageant ni méprisant à l'égard d'un groupe, pris dans son ensemble, de personnes à raison de leur origine ou de leur religion (Crim. 13 nov. 2019, n° 18-85.267 FS-D).
La Cour de cassation approuve en revanche la cour d'appel ayant jugé le délit de diffamation raciale comme constitué en raison de la couverture d'un ouvrage, associant les mots « juifs » et « escrocs ». La Cour a considéré que ladite couverture visait l'ensemble des juifs en raison de la composition de la page et qu'il n'avait pas été soutenu en cause d'appel que le contenu de l'ouvrage aurait pu contredire cette définition du groupe visé. La Cour ajoute que « s'il appartient aux juges de relever toutes les circonstances qui sont de nature à leur permettre d'apprécier le sens et la portée des propos incriminés et de caractériser l'infraction poursuivie, c'est à la condition, s'agissant des éléments extrinsèques auxdits propos, qu'ils aient été expressément invoqués devant eux ». Tout est affaire de contexte, mais encore faut-il que celui-ci soit invoqué (Crim. 15 oct. 2019, no 18-85.366 F-P+B+I).
La Cour approuve également l'analyse des juges du fond selon laquelle l'injure à caractère racial était caractérisée par la publication de la fausse publicité « Judéotril ». En effet, les propos sont outrageants envers les adeptes de la religion juive, présentés comme atteints de troubles et de maladies. Les propos s'appliquaient bien aux personnes elles-mêmes et ne visaient pas seulement les préceptes religieux du judaïsme. Ils étaient ainsi injurieux à l'égard d'un groupe de personnes, défini par leur appartenance religieuse (Crim. 15 oct. 2019, no 18-85.365 F-D).
En matière d'infractions aggravées à raison de l'orientation sexuelle, les juges du fond se refusent à dissocier les orientations sexuelles et identités de genre des personnes elles-mêmes, malgré les tentatives de certains prévenus de se prévaloir une telle défense.
Aussi la Cour d’appel de Paris a-t-elle jugé que le propos de Jean-Marie Le Pen établissant un lien positif entre homosexualité et pédophilie « vise bien un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, dès lors que “l'homosexualité” n'est pas une doctrine ou une théorie qui pourrait être librement critiquée, mais induit des comportements sexuels inhérents à une orientation sexuelle, de sorte que le terme vise les personnes homosexuelles elles-mêmes dans leur ensemble » (Paris, pôle 2 - ch. 7, 3 oct. 2019, n° 19/00003, Association Mousse c/ J.-M. Le Pen).
Elle a également confirmé la condamnation pour injure aggravée du même prévenu qui avait déclaré que l'homosexualité d'un policier, auquel il était rendu hommage lors d'une cérémonie publique, est une « particularité familiale » devant être « tenue à l'écart » de ce genre d'événement. La Cour juge que le prévenu généralise son propos et donc qu'il vise bien un groupe de personnes considérées dans leur ensemble à raison de leur orientation sexuelle (Paris, pôle 2 - ch. 7, 3 oct. 2019, n° 19/00017, J.-M. Le Pen c/ Etienne C.).
III - Infractions
A - Diffamation
1 - Imputation de faits précis
La diffamation doit consister en l'imputation d'un fait précis, susceptible de preuve et d'un débat contradictoire. Aussi les juges du fond ont-ils eu l'occasion de réaffirmer que l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur ne sauraient relever d'une telle catégorie.
Dans deux espèces distinctes, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que des propos visés comme diffamatoires portant sur la définition de la notion d'islamophobie, d'une part, ou sur la signification du port du voile, d'autre part, ne comportaient l'imputation d'aucun fait précis susceptible de preuve ou d'un débat contradictoire, mais relevaient de l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur (TGI Paris, 17e ch., 18 juin 2019, n° 16090000191, CCIF c/ I. Kersimon et 19 nov. 2019, n° 18046000969, Latifa Ibn Ziaten c/ M. Sifaoui).
Dans la première espèce, peu importe que le prévenu ait utilisé le champ lexical de la certitude, celui-ci ne confère pas pour autant aux propos le caractère de faits précis. Dans la seconde, le tribunal juge que le propos relève d'une opinion sur les liens entre le port du voile et l'idéologie de l'islam politique, le prévenu exprimant son étonnement sur le port du voile par une femme victime du terrorisme. Le tribunal précise qu'il ne lui appartient pas « de trancher les débats historiques ou théologiques sur l'origine et le sens du port du voile ».
2 - Imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération
On le rappelle, l'atteinte à l'honneur et à la considération s'apprécie de manière objective, d'après la nature du fait imputé. L'atteinte est aisément reconnue par les juges lorsque le propos impute la commission d'une infraction pénale. Certaines imputations portant sur des faits pouvant être qualifiés pénalement ou à la limite entre moralité et criminalité, présentent cependant plus de difficultés. Il appartient dès lors aux juges d'interpréter le propos pour en déterminer le sens et la portée et relever en quoi la nature des faits imputés porte objectivement atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée. Plusieurs décisions rendues cette année permettent d'apprécier le contrôle exercé par la Cour de cassation sur les travaux d'herméneutique littéraire auxquels se livrent alors les juges du fond.
Dans une décision en date du 12 mars 2019, elle approuve ainsi la cour d'appel qui relève « que, si le fait de réaliser un film pornographique n'est pas en tant que tel attentatoire à l'honneur ou à la considération », l'article poursuivi révélait « qu'il a été tourné dans une mairie par un réalisateur qui aurait abusé de sa fonction d'adjoint au maire en filmant des images à caractère pornographique ou érotique sans égard pour la solennité et la respectabilité d'un hôtel de ville ». Elle en a déduit à bon droit que les propos litigieux étaient diffamatoires (Crim. 12 mars 2019, n° 18-82.750 F-D).
La Haute juridiction approuve également l'interprétation de la cour d'appel pour laquelle les propos « Nous avons la preuve que [le maire] a financé un certain nombre d'organisations proches de l'UOIF qui est une organisation qualifiée de terroriste par un certain nombre de pays dont les Émirats arabes unis » n'imputent pas à la partie civile d'avoir apporté une aide consciente et délibérée à une organisation reconnue en France comme terroriste, mais seulement d'avoir financé l'islamisme, en apportant une aide à des organisations proches de l'UOIF, que certains pays qualifient de terroriste. Les propos sont polémiques mais pas diffamatoires (Crim. 12 mars 2019, n° 18-81.707 F-D).
3 - Faits justificatifs
a - Exception de vérité
Les critères pour démontrer la vérité des imputations diffamatoires sont particulièrement stricts, rendant ainsi les décisions des tribunaux rarissimes.
Dans les cas où l'imputation porte sur la commission d'infractions pénales, les tribunaux exigent en effet la production d'une condamnation définitive. Cette sévérité était illustrée cette année par deux jugements de la 17e chambre du Tribunal de grande instance de Paris, portant sur des diffamations par l'imputation de faits de harcèlement sexuel. Dans un cas, les juges exigeaient clairement, s'agissant de faits de nature délictuelle, la production d'un jugement de condamnation devenu définitif (TGI Paris, 17e ch. civ., 25 sept. 2019, n° 18/00402, E. Brion c/ S. Muller et a.).
Dans la seconde affaire, les juges notaient qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que la partie civile aurait été condamnée définitivement pour des faits de harcèlement. Ils poursuivaient leur analyse en précisant qu'il ne résulte pas non plus des pièces produites qu'il aurait été « renvoyé devant un tribunal ou même simplement mis en examen, pour les faits décrits dans l'article, de sorte que la preuve parfaite n'est pas rapportée » (TGI Paris, 17e ch., 19 avr. 2019, n° 16/13800773, D. Baupin c/ M Gallet et a.). Une décision de renvoi ou de mise en examen aurait-elle donc en réalité suffi à rapporter la preuve de la vérité des faits imputés ? Il est permis d'en douter.
Néanmoins, il nous semble qu'une appréciation plus souple de cette exceptio veritatis permettrait de ne pas laisser ce fait justificatif tomber en désuétude, surtout dans des dossiers où les personnes poursuivies ne sont pas des journalistes. En effet, la jurisprudence est si stricte à l'heure actuelle que nombre de praticiens ont même renoncé à notifier des offres de preuve…
b - Bonne foi
L'auteur de propos diffamatoires peut classiquement établir sa bonne foi en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, de respect du contradictoire ainsi que de prudence dans l'expression. Sous l'influence de la Cour européenne des droits de l’homme, l'appréciation des critères de la bonne foi a évolué en consacrant la notion de sujet d'intérêt général. L'auteur des propos doit alors établir qu'il détenait une « base factuelle suffisante » au moment de leur publication.
La base factuelle et plus généralement la bonne foi, requierent des éléments moins précis que ceux exigés au titre de la vérité du fait diffamatoire, puisque la bonne foi n'exige pas pour être accordée une preuve parfaite des faits imputés. La Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler s'agissant de la publication d'un article diffamatoire à l'encontre d'un procureur de la République. Elle a considéré en effet que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en rejetant la bonne foi invoquée par le prévenu. Il lui incombait de rechercher, au regard du sujet d'intérêt général traité, si les propos reposaient sur une base factuelle, sans subordonner l'existence de celle-ci à la preuve de la vérité des faits (Crim. 26 nov. 2019, n° 18-85.046 F-D).
Aussi, la sévérité de l'analyse des juges apparaît inversement proportionnelle à l'intensité du débat d'intérêt général. La Cour d’appel de Paris juge ainsi que « même s'il n'était pas très prudent » de la part de journalistes « de mettre en avant leur interprétation personnelle des écoutes » qu'ils rapportaient, il n'en demeure pas moins qu'il est justifié d'une base factuelle suffisante et que « dans le cadre d'un article ayant trait au rôle de la presse et à ses liens avec la justice dans une société démocratique, ce qui relève d'un intérêt public majeur, spécialement au sujet d'une affaire de soupçons de financement électoral illégal, la condamnation des journalistes, poursuivis par un autre journaliste, constituerait une atteinte disproportionnée au droit fondamental à la liberté d'expression ainsi qu'au droit du public à être informé, garantis par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et les libertés fondamentales » (Paris, 21 nov. 2019, n° 444/2019).
Encore faut-il que les propos n'aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d'expression. Ces principes ont été rappelés par les juges de la 17e chambre du Tribunal de grande instance de Paris, à l'occasion du jugement condamnant la journaliste initiatrice de #BalanceTonPorc pour diffamation à l'encontre de l'ancien patron de la chaîne Équidia, dont il a été interjeté appel.
Dans cette affaire, les juges ont énoncé que si la question des violences faites aux femmes, dans le contexte de l'affaire Weinstein et au-delà, constitue à l'évidence un sujet d'intérêt général, l'auteur du tweet ne disposait pas d'une base factuelle suffisante pour tenir les propos litigieux, accusant le demandeur de faits particulièrement graves dans des termes virulents et ayant dégénéré en des attaques personnelles (TGI Paris, 17e ch. civ., 25 sept. 2019, E. Brion c/ S. Muller).
Les critères de la bonne foi sont en outre appréciés différemment selon le genre de l'écrit en cause, la qualité de la personne visée et celle de la personne s'exprimant.
La bonne foi doit être appréciée plus souplement en matière de polémique historique ou politique. La Cour de cassation approuve ainsi l'exception de bonne foi accordée au prévenu pour des propos rappelant une condamnation dans des termes pourtant juridiquement impropres, dans la mesure où ces propos s'inscrivaient dans la cadre d'une polémique politique et reposaient sur une base factuelle suffisante. L'auteur des propos s'était en effet exprimé dans le feu d'un débat animé avec une journaliste, au sujet d'une candidate d'une liste concurrente aux élections régionales (Crim. 8 janv. 2019, n° 18-81.286, Philippe X.).
Relèvent également du débat d'intérêt général et de la polémique historique, les propos portant sur la qualification de « génocide » des faits subis par les Arméniens de l'Empire ottoman en 1915. La Cour d’appel de Paris rappelle qu'une particulière liberté de ton peut être admise dès lors qu'un prévenu s'exprime dans le cadre d'une telle polémique historique et politique vive et douloureuse et juge qu'au cas d'espèce les limites admissibles de la liberté d'expression n'ont pas été dépassées (Paris, pôle 2 - ch. 7, 28 mars 2019, n° 17/08387, Maxime G. et a. c/ Samuel T. et a.).
Les juges apprécient également moins strictement les critères de la bonne foi lorsque l'auteur des propos n'est pas un journaliste professionnel de l'information ou lorsque celui-ci ne s'exprime pas en cette qualité, notamment s'il est personnellement impliqué dans les faits qu'il dénonce (TGI Paris, 17e ch. civ., 25 sept. 2019, E. Brion c/ S. Muller). La solution est logique puisque le prévenu n'étant pas un professionnel de l'information, il n'est pas tenu aux mêmes exigences déontologiques qu'un journaliste (Crim. 15 oct. 2019, n° 18-83.255, Didier S.).
En revanche, le travail des journalistes reste soumis à un contrôle de proportionnalité plus exigeant s'agissant de la base factuelle suffisante et notamment du caractère contradictoire du travail réalisé, c'est-à-dire de l'enquête journalistique.
La Cour de cassation a ainsi jugé que des propos traitant d'un sujet d'intérêt général, en l'espèce le comportement d'élus dans l'exercice de leurs fonctions, ne reposaient pas « sur une base factuelle suffisante, faute pour le journaliste d'avoir satisfait à ses obligations de contradiction et de vérification et d'avoir, ainsi, procédé à une enquête sérieuse ». La cour d'appel avait relevé « que le journaliste n'a pas fait état des dénégations du maire sortant (…) ni recherché à recueillir le point de vue de la partie civile » et reprenait « à son compte la position du nouveau maire, sans vérification » (Crim. 12 mars 2019, n° 18-82.750 F-D).
Si le respect du principe du contradictoire est un indice fondamental d'une enquête sérieuse, il n'est cependant pas toujours indispensable de contacter tous les protagonistes d'une affaire. La cour d'appel affirme ainsi que dans le cas où le requérant n'est pas le personnage central d'une affaire et que sa position est indirectement fournie, le caractère contradictoire de l'enquête est établi (Paris, pôle 2 - ch. 7, 7 mars 2019, n° 18/06438, Rodrigue N. c/ L. Dreyfus et a.).
Enfin, les juges du fond ne peuvent déduire l'existence d'une animosité personnelle de la seule circonstance que l'auteur de l'article ou d'autres journalistes du même journal avaient précédemment publié des articles critiques à l'égard de la partie civile (Crim. 26 nov. 2019, n° 18-85.046 F-D).
En tout état de cause, il est attendu des juges du fond qu'ils s'expliquent sur la consistance de la base factuelle.
Dans une décision du 15 octobre 2019, la Cour de cassation rappelle que les juges doivent nécessairement examiner les pièces produites et expliciter les éléments sur lesquels ils fondent leur décision sur la bonne foi : « si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision » (Crim. 15 oct. 2019, n° 18-83.255 F-P+B+I).
B - Injure
1 - Caractérisation de l'injure
L'injure est définie négativement par rapport à la diffamation comme toute expression outrageante, termes de mépris ou d'invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. La distinction entre ces deux infractions est primordiale, notamment parce que le juge de presse, on le rappelle, n'a pas la possibilité de requalifier en cas d'erreur dans le choix de la qualification opérée par le requérant et qu'ainsi la relaxe s'impose.
Ainsi, Jean-Marie Le Pen, qui poursuivait pour injure l'auteur des propos « La gégène c'est dans les gènes des LE PEN », a été débouté de ses demandes, la cour d'appel considérant, après une analyse du contexte, que les propos lui imputaient en réalité des faits précis, à savoir d'avoir adopté des prises de position légitimant la torture (Paris, pôle 2 - ch. 7, 11 sept. 2019, n° 18/05870, J.-M. Le Pen c/ B. Le Roux). En revanche, ne sont pas considérés comme des faits précis les propos analysés comme une opinion, un état d'esprit, car insusceptibles de preuve (TGI Paris, 17e ch. civ., 6 févr. 2019, Isabelle G. et a. c/ Guillaume T. et a.).
Il est également impératif de prêter attention à la qualification choisie lorsque plusieurs séries de propos sont poursuivies de manière simultanée. En effet l'injure est absorbée par les imputations diffamatoires lorsqu'elles sont indissociables les unes de l'autre. L'injure dans cette hypothèse doit être poursuivie sur le seul fondement de la diffamation. C'est le sens de l'arrêt, somme toute classique, rendu par la Cour de cassation le 7 mai 2019, dans lequel elle approuve la cour d'appel qui a jugé que les injures poursuivies sont absorbées par la diffamation, car « chacune des deux expressions outrageantes poursuivies est indissociable des imputations diffamatoires contenues dans l'article qui les renferme, de sorte qu'elles ne pouvaient être poursuivies séparément » (Crim. 7 mai 2019, n° 18-82.734 F-D).
Il est dès lors nécessaire de se livrer à une analyse fine des propos eux-mêmes, ainsi que de leur contexte, pour apprécier objectivement leur sens et leur portée. Seront considérés comme des expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives les propos « bande de bâtards » utilisés à l'encontre de policiers hors de tout jugement sur une opération donnée (TGI Paris, 17e ch. corr., 19 sept. 2019, n° 181020000778, Procureur de la République c/ M. Kassovitz). Il en va de même s'agissant du terme « nazi », qui employé seul pour désigner un homme politique est considéré comme « outrageant et objectivement injurieux » (Paris, pôle 2 - ch. 7, 18 sept. 2019, n° 18/06670, J.-M. Le Pen c/ J. Séguéla). La Cour de cassation approuve également que les propos « c'est un pauvre type » présentent un caractère injurieux (Crim. 18 juin 2019, n° 18-83.886).
2 - Faits justificatifs
On constate une certaine unification des faits justificatifs en matière de presse. L'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sert en effet de plus en plus à justifier la relaxe y compris en matière d'injure, au regard des « limites admissibles de la liberté d'expression ». L'excuse de provocation n'a en revanche presque jamais été retenue dans le cadre des décisions relatives aux injures (Paris, pôle 2 - ch. 7, 18 sept. 2019, n° 18/06670, J.-M. Le Pen c/ J. Séguéla ; Crim. 18 juin 2019, n° 18-83.886).
L'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation est à ce titre assez éloquent. L'affaire portait sur la diffusion lors de l'émission On n'est pas couché sur France 2, d'une affiche parodique publiée trois jours avant par Charlie Hebdo et représentant Marine Le Pen, alors candidate aux présidentielles, sous la forme d'un excrément. La chambre criminelle, exerçant son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis, cassait et annulait la décision de relaxe de l'animateur et du président de la chaîne, au visa des dispositions de la loi sur la presse et de la Convention européenne des droits de l'homme, considérant que la liberté d'expression avait été dépassée en raison de l'atteinte portée à la dignité de la personne.
Mais la cour de renvoi confirmait le jugement en ses dispositions civiles. Saisie du pourvoi de la partie civile, l'Assemblée plénière le rejette au visa de l'article 10. Selon elle, la dignité « ne figure pas, en tant que telle, parmi les buts légitimes énumérés » par cet article. Ainsi elle « ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d'expression ». Elle estime ensuite que « la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée de cette affiche à la lumière des éléments extrinsèques qu'elle a souverainement analysés, en a déduit, à bon droit, que la publication litigieuse ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression ». L'assemblée plénière approuve donc l'analyse de proportionnalité opérée par les juges du fond, selon laquelle le ton satirique du journal, le contexte électoral, l'absence d'attaque personnelle et la distanciation prise par l'animateur permettent de considérer que les limites admissibles de la liberté d'expression n'ont pas été dépassées.
L'injure, bien que parfaitement caractérisée est donc neutralisée par l'article 10, dans une mise en balance des intérêts similaire à celle que l'on retrouve s'agissant de de la bonne foi en matière de diffamation (Cass., ass. plén., 25 oct. 2019, n° 17-86.605 P+B+R+I).
S'agissant du publicitaire Jacques Séguéla, qui avait qualifié Jean-Marie Le Pen de « nazi », la Cour d’appel de Paris, après avoir considéré les propos comme injurieux, se penche sur les limites admissibles de la liberté d'expression. Elle relève tout d'abord la profession du prévenu : celui-ci n'est pas un homme politique s'exprimant dans un débat électoral. Il s'agit d'un publicitaire qui connaît parfaitement le sens et la portée des mots. Si une plus grande liberté de ton est admise envers un homme politique qui s'expose à la critique, la liberté d'expression à son sujet ne peut pour autant être sans limite. La cour conclut que l'emploi du mot « nazi » pour désigner Jean-Marie Le Pen dans le contexte en cause ne peut s'analyser en une simple opinion sur un positionnement idéologique d'un personnage politique public, notamment en raison de l'outrance du terme employé (Paris, pôle 2 - ch. 7, 18 sept. 2019, n° 18/06670, J.-M. Le Pen c/ J. Séguéla).
Le Tribunal de grande instance de Paris a également jugé cette année, s'agissant de propos s'inscrivant dans une polémique liée au référendum irlandais sur l'avortement que « dans le contexte de débats publics et d'une vive polémique, l'expression d'une libre opinion, sur l'action et les prises de position de la personne visée, peut enlever aux propos leur caractère injurieux, à condition que ne soit pas dépassées les limites admissibles de la liberté d'expression » (TGI Paris, 17e ch. civ., 6 févr. 2019, Isabelle G. et a. c/ Guillaume T. et a.).
La cour d'appel avait refusé le bénéfice de la bonne foi à Alain Soral, poursuivi notamment pour injures à raison de l'orientation sexuelle envers Pierre Bergé. Le prévenu s'est pourvu en cassation. La Haute juridiction relève cependant, que « dès lors que les propos constitutifs d'injures visant la personne concernée en raison de son origine ou de son orientation sexuelle, dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d'expression dans une société démocratique, ne relèvent pas de la libre critique, participant d'un débat d'intérêt général, la cour d'appel a justifié sa décision » (Crim. 19 févr. 2019, n° 18-82.745, A. Soral).
C - Négationnisme
La Haute juridiction approuve la décision de la cour d'appel qui, pour dire non constitué le délit de contestation de crime contre l'humanité, a retenu que le dessin litigieux, visant à dénoncer l'exploitation mercantile que la communauté juive ferait de la mémoire des victimes des camps d'extermination, ne tend pas pour autant à nier ou à largement minimiser les crimes contre l'humanité commis par les nazis à l'encontre de la communauté juive (Crim. 26 nov. 2019, n° 19-80.782 F-D, Licra c/ A. Soral).
D - Provocation
Après une période de revirements, la jurisprudence de la Cour de cassation semble se stabiliser en faveur d'une interprétation restrictive des provocations, qui pour être constituées nécessitent un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite, à la haine, à la violence ou à la discrimination.
La Haute juridiction approuve la décision de la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus du chef de provocation à la discrimination raciale, énonce que la loi pénale est d'interprétation stricte et que ce délit suppose un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite, absents en l'espèce. Elle énonce que, quelque déplacé que soit le message incriminé, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés (Crim. 26 nov. 2019, n° 19-80.782 F-D). En outre, elle rappelle que le sens et la portée des propos doivent être recherchés « au regard de la compréhension du lecteur moyen qui en prend connaissance à la date de sa diffusion » et approuve ainsi la cour d'appel qui a « refusé de prendre en compte à cette fin des messages ou discours postérieurs à leur diffusion » (Crim. 4 juin 2019, n° 18-82.742).
Dans l'affaire du dessin Shoah Business publié par Alain Soral sur son site et pour lequel il avait été condamné pour provocation aggravée en première instance, la cour d'appel retient, contrairement aux premiers juges et en se référant précisément au revirement opéré le du 7 juin 2017 par la Cour de cassation, que le dessin ne contient aucune exhortation, implicite ou explicite à la haine envers les Juifs. Rappelant le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et l'article 10 de la Convention européenne, elle invoque également la sécurité juridique en affirmant que la jurisprudence de la Cour a déjà largement fluctué sur ce point et que « des revirements incessants de jurisprudence ne pourraient que nuire à la sécurité juridique, ainsi qu'à la prévisibilité et à l'intelligibilité de la justice ». En l'espèce, les propos auraient pu être poursuivis sur le fondement de la diffamation aggravée mais étant antérieurs à la loi du 27 janvier 2017 ayant autorisé les juridictions à requalifier les faits poursuivis en matière d'infraction de presse à caractère discriminatoire, une telle requalification est impossible. Elle infirme donc le jugement en toutes ses dispositions pénales (Paris, pôle 2 - ch. 7, 9 mai 2019, n° 18/07715, Licra et a. c/ A. Soral).
Reste que l'appel peut encore être « implicite » et qu'en outre, la jurisprudence n'exige pas non plus un appel explicite à la commission d'un fait précis dès lors que « tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence ». La Cour semble dès lors avoir ménagé une marge d'interprétation en fonction du contexte et notamment des éléments extrinsèques aux propos.
Ainsi la Cour de cassation confirme par exemple la condamnation au titre de la provocation d'Hervé Ryssen, qui avait déclaré « Pas compliqué : tant que vous n'accuserez pas les juifs de leurs innombrables crimes, ce sont eux qui vous accuseront des leurs ». Elle approuve en effet la décision de la cour d'appel ayant jugé que le message constituait le délit de provocation, en ce qu'il incitait le lecteur à accuser les Juifs de leurs crimes afin d'éviter d'en être accusés par eux, les Juifs étant ainsi visés sans distinction. Pour la Cour, ce propos exhortait le public, à tout le moins implicitement, à la discrimination envers un groupe de personnes visées en raison de leur appartenance religieuse (Crim. 15 oct. 2019, n° 18-85.368). De la même façon, les propos d'Éric Zemmour qui affirmait « je pense qu'il faut leur donner le choix entre l'islam et la France » constituent une provocation implicite à la discrimination envers les musulmans (Crim. 17 sept. 2019, n° 18-85.299 F-D).
La Cour de cassation approuve également l'arrêt de la cour d'appel qui a retenu que le délit de provocation était constitué, dès lors que deux des propos contenaient un appel explicite à la discrimination envers les Juifs par l'imposition du port d'un signe distinctif. Le message par lequel le prévenu affirmait péremptoirement qu'il y a « trop de Noirs » et « trop de juifs », laissait quant à lui entendre qu'il faut qu'il y en ait moins et constituait, de façon implicite, un appel à la discrimination envers ces personnes (Crim. 15 oct. 2019, n° 18-85.365 F-D).
En revanche, s'agissant des propos « Les homosexuels c'est comme le sel dans la soupe, si y en a pas du tout c'est un peu fade, mais si y en a trop c'est imbuvable », la Cour d’appel de Paris juge que les propos ne constituent pas un appel implicite à la haine, ni à la violence envers les personnes homosexuelles (Paris, pôle 2 - ch. 7, 3 oct. 2019, n° 19/00003, Association Mousse c/ J.-M. Le Pen). Elle juge également que les propos de J.-M. Le Pen suggérant que l'homosexualité est une « particularité familiale » qui « doit être tenue à l'écart » de certaines cérémonies publiques ne comportaient pas d'appel explicite ni implicite à la haine ou à la violence à raison de l'orientation sexuelle. Le fait de « mettre à l'écart » ne sous-entendant pas une exhortation sous-jacente à se montrer violent ou haineux envers l'ensemble des personnes homosexuelles (Paris, pôle 2 - ch. 7, 3 oct. 2019, n° 19/00017, J.-M. Le Pen c/ Etienne C.).
On peut s'étonner de ces deux décisions de relaxe, lorsqu'on les compare à celles précédemment citées en matière de provocation à caractère raciale. Mais la provocation, lorsqu'elle vise la discrimination à caractère homophobe, est définie de façon plus restreinte que la provocation à la discrimination raciale. En effet, la première vise spécifiquement la discrimination telle que prévue par certains articles du code pénal tandis que la seconde vise la discrimination en général. Aussi nous semble-t-il que la jurisprudence en cette matière pourrait bénéficier d'une harmonisation des incriminations de provocations aggravées.




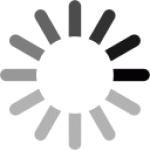
 S'abonner à Legipresse
S'abonner à Legipresse Feuilleter le dernier numéro
Feuilleter le dernier numéro