(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Les 2 derniers inscrits
Vidéos
L'art de l'appropriation ou l'art de la contrefaçon : dernier épisode en date de la saga judiciaire de Jeff Koons
La cour rappelle que le droit à la liberté d'expression artistique doit s'exercer dans le respect des autres droits fondamentaux, tels que le droit de propriété dont découle le droit d'auteur. En l'espèce, la mise en œuvre de la protection de la photographie Fait d'hiver au titre du droit d'auteur constitue une atteinte proportionnée et nécessaire à la liberté d'expression créatrice de Jeff Koons.
« Il fut un temps où Picasso, Warhol et Duchamp empruntaient impunément aux œuvres d'autrui. Dans les années 80, on traitait les artistes américains de cupides arrivistes qui ne pensaient qu'à leur compte en banque. Les photographes de cartes postales ont déployé une armée d'avocats pour nous intenter des procès abusifs pour violation du copyright. Il nous faut toujours assurer nos arrières, même si je reste convaincu que l'appropriation artistique est honnête »(1). C'est par ces mots que le plasticien américain Jeff Koons défend sa démarche créative qui s'inscrirait, selon lui, dans le mouvement artistique contemporain dit d'appropriation.
Le musée de la Tate Gallery à Londres définit le mouvement d'appropriation comme « la pratique des artistes qui utilisent des objets ou des images préexistants dans leur art en transformant peu l'original »(2). Celui-ci remonterait à Picasso et Braque avec leurs collages et constructions cubistes (1912) puis Marcel Duchamp et son fameux urinoir intitulé Fontaine (1917). Andy Warhol en est une figure emblématique. Ce mouvement se serait ensuite beaucoup développé à compter des années 1980, notamment avec Jeff Koons.
Certains – dont le plasticien américain – soutiennent que cette démarche devrait échapper à l'emprise du droit d'auteur et être automatiquement couverte par le jeu des exceptions au monopole (la parodie, voire de manière plus extensive, la liberté d'expression artistique et le fair use aux États-Unis). Ce serait dévoyer les règles du droit d'auteur et inverser les axiomes classiques – le droit d'auteur deviendrait une exception et les exceptions le principe – en ignorant le caractère limitatif des exceptions et nier l'interprétation stricte, en faveur du monopole de l'auteur, à laquelle elles sont soumises(3).
La décision rendue par la cour d'appel de Paris le 23 février 2021 doit être saluée en ce qu'elle réaffirme les principes fondateurs avec rigueur en considérant que l'appropriation d'une œuvre sans autorisation constitue une contrefaçon.
Pour mémoire, M. Franck Davidovici, directeur artistique, avait réalisé une campagne publicitaire pour la société Naf-Naf en 1985 représentant « une jeune femme brune aux cheveux courts, allongée dans la neige, un petit cochon penché au-dessus d'elle avec un tonneau de Saint-Bernard autour du cou ». La photographie était intitulée Fait d'hiver et avait été publiée dans plusieurs magazines.
En 2014, à l'occasion d'une rétrospective dédiée à l'artiste Jeff Koons au Centre Pompidou, M. Davidovici s'est aperçu que l'une des sculptures exposées, issue de la série Banality, présentait des ressemblances avec son visuel (même composition d'une femme brune allongée dans la neige avec un petit cochon près d'elle). Il a en conséquence assigné, sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur, l'artiste, sa société, le musée et l'éditeur du catalogue de l'exposition dans laquelle l'œuvre litigieuse était présentée.
Dans un jugement du 8 novembre 2018(4), le tribunal a reconnu les actes de contrefaçon et a condamné les défendeurs à d'importantes peines pécuniaires (218 000 € toutes causes de préjudices confondus y compris l'art. 700 c. pr. civ.).
L'artiste et sa société ont alors interjeté appel, ce qui a donné lieu à la décision commentée qui apparaît garante d'une certaine sécurité juridique pour la communauté artistique. Elle est en effet conforme aux règles applicables (I) et fait primer le droit de propriété de l'auteur sur de prétendus droits fondamentaux que détiendraient les contrefacteurs (II).
I - Une décision conforme aux règles du droit d'auteur
La cour d'appel a eu à analyser pratiquement tous les moyens pouvant être invoqués par un contrefacteur pour tenter d'échapper à sa responsabilité(5).
Sur le fond, Jeff Koons soulevait en premier lieu l'absence d'originalité de l'œuvre de M. Davidovici, qu'il considère banale, ce qui peut à première vue surprendre. Est-il en effet vraiment raisonnable de soulever que l'œuvre première ne serait qu'une « simple juxtaposition imprécise d'idées » alors que l'artiste se l'est appropriée – ce qu'il reconnaît – pour ensuite l'exposer dans les musées les plus prestigieux du monde et en faire un objet du commerce fortement valorisé (sa sculpture en porcelaine a été vendue 3 millions de dollars en 2007 chez Christie's) ?
Une création n'existant principalement que par l'apport d'une œuvre préexistante, aurait-elle une valeur pécuniaire aussi importante si cette dernière était vraiment dépourvue d'originalité ? Cela est discutable. C'est pourquoi la cour adopte les motifs du tribunal sur ce point et considère que la photographie est originale en raison notamment de la combinaison inattendue entre une femme allongée dans la neige et un petit cochon se portant à son secours, ce qui révèle les choix arbitraires de son auteur.
Jeff Koons écartait par ailleurs le grief de contrefaçon en alléguant que la transformation de l'œuvre première était telle que l'œuvre seconde présentait suffisamment de différences pour y échapper. L'artiste semble se contredire. Comme évoqué à titre liminaire, le mouvement d'appropriation revendique très peu, voire parfois aucune transformation de l'œuvre première, comme d'ailleurs le courant artistique du ready-made inventé par Marcel Duchamp(6), précisément évoqué par Jeff Koons dans la procédure pour justifier sa démarche. C'est l'essence même de ces mouvements : on s'approprie ce qui existe pour le détourner mais sans (trop) le modifier afin de ne pas s'en démarquer démesurément (on pense ainsi immédiatement à l'urinoir de Duchamp ou au portrait de Marylin repris par Warhol).
Aussi, comment Jeff Koons peut-il raisonnablement revendiquer s'inscrire dans une telle démarche et en même temps s'en démarquer, et invoquer une transformation radicale de la photographie prise pour Naf-Naf au point que les œuvres comparées « ne présentent pas un même aspect général d'ensemble » selon lui ?
L'artiste opère également un raisonnement pour le moins surprenant en invoquant l'originalité de son propre travail qui ne pourrait dès lors constituer une contrefaçon parce qu'il se « démarque nécessairement de l'art antérieur ».
Ce serait méconnaître la qualification d'œuvre dérivée, aussi appelée composite, qui donne prise au droit d'auteur (CPI, art. 113-4). L'originalité de celle-ci n'est pas un rempart contre le grief de contrefaçon. Comme l'énonçait déjà Desbois, il est en effet possible de faire « preuve d'originalité dans la servilité » de sorte que l'œuvre seconde est « à la fois bénéficiaire et tributaire des droits d'auteur »(7). Cette dualité nécessite en conséquence l'autorisation de l'auteur de l'œuvre première. C'est l'apport de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle qui précise que l'adaptation ou la transformation d'une œuvre ne peut être faite qu'avec le consentement de son auteur. Ce que n'ignore pourtant pas Jeff Koons(8).
Après un examen minutieux des œuvres et au regard de la reproduction des éléments caractéristiques du visuel de M. Davidovici par Jeff Koons, associée au peu de transformation opérée par celui-ci, la cour d'appel retient également le grief de contrefaçon. Comme pour le tribunal, les ressemblances sont selon elle prédominantes par rapport aux différences alléguées.
Probablement conscient de cette faiblesse, Jeff Koons avait également tenté d'invoquer à titre subsidiaire l'application de la loi américaine pour en tirer l'argument du fair use, c'est-à-dire l'usage raisonnable, loyal d'une œuvre, permettant de se dispenser de l'autorisation de son auteur. La cour a rejeté ce moyen, au profit de la loi française, en raison de la localisation des faits litigieux en France (exposition au Centre Pompidou à Paris). Il n'est de toute façon pas certain que cet argument aurait prospéré au regard du dernier état de la jurisprudence américaine qui restreint l'application de cette exception en faveur du copyright.
La décision de la cour d'appel paraît en conséquence juste et protectrice des intérêts des auteurs dont les œuvres sont le fruit de leur travail et la plupart du temps leur unique source de revenus. Le monopole ne doit en effet connaître que d'exceptions limitées et non diluées, sous couvert de prétendus droits fondamentaux que pourrait invoquer le contrefacteur contre l'auteur pour se soustraire à sa responsabilité.
II - La balance des intérêts entre le droit de propriété de l'auteur et les prétendus droits fondamentaux du contrefacteur
Pour échapper au grief de contrefaçon, Jeff Koons a invoqué les arguments qu'il met systématiquement en avant, tant devant les juridictions françaises qu'américaines : l'exception de parodie et la liberté d'expression artistique.
Rappelons que la parodie, exception prévue à l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle et fondée sur le principe de la liberté d'expression, suppose un travestissement de l'œuvre première par l'auteur de l'œuvre seconde dans le seul but de faire rire. La jurisprudence européenne est venue préciser les conditions de cette exception en établissant que la parodie devait « évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci » et « constituer une manifestation d'humour ou une raillerie ». En l'espèce, aucune des conditions ne paraît remplie. Comme le souligne la cour, Jeff Koons qui a longuement décrit son œuvre pour les besoins de la procédure, n'a en effet à aucun moment évoqué le prétendu message humoristique véhiculé par celle-ci, lequel n'apparaît pas non plus de manière évidente à la vue de la sculpture.
L'artiste semble par ailleurs se contredire une nouvelle fois en soutenant à la fois l'application de l'exception, qui suppose l'évocation de l'œuvre première, et le fait que celle-ci aurait eu une « exploitation très limitée ». Le Centre Pompidou ajoute d'ailleurs qu'il n'avait aucune connaissance de la photographie contrefaite et la cour en conclut même qu'elle était inconnue du public. Si Jeff Koons soutient que le bénéfice de l'exception ne requiert pas que l'œuvre parodiée soit notoire, il faut malgré tout que le public, à qui elle est destinée, puisse l'identifier pour percevoir et apprécier la portée de la parodie. Celle-ci s'adresse en effet au public dans le but de le faire rire et ce n'est qu'en pouvant identifier l'œuvre première que le but recherché peut être atteint (même s'il ne l'est pas toujours forcément, l'important est qu'il puisse l'être). L'évocation de l'œuvre première faisant également défaut, la cour n'avait d'autre choix que de confirmer le rejet de l'exception.
L'artiste américain soulève enfin le bénéfice de la liberté d'expression artistique et invoque, de manière contestable, un prétendu droit fondamental tiré de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se place ainsi au même rang que l'auteur pour justifier son comportement et ainsi faire échec à son monopole. Le Centre Pompidou invoque quant à lui un devoir d'information au public assis sur le même fondement.
Il revient alors à l'auteur, de manière étonnante mais bien ancrée désormais, de prouver que son droit de propriété est légitime et constitue une limite proportionnée à l'éventuelle liberté d'expression artistique du contrefacteur. Sur quel fondement peut-on en effet justifier de placer sur un même plan l'auteur et son contrefacteur et ainsi appliquer la fameuse balance des intérêts ?
De manière claire et avec une volonté marquée de protéger le travail des auteurs, la cour rappelle que rien ne nécessitait que Jeff Koons fasse l'économie d'un travail créatif et rien ne pouvait dès lors justifier la démarche créative du plasticien, eu égard notamment au fait que l'œuvre première était inconnue du public. Les juges considèrent au surplus qu'eu égard à sa « position privilégiée sur le marché de l'art », Jeff Koons ne pouvait utiliser le travail d'un autre artiste en s'exonérant de le rémunérer alors qu'il avait lui-même une démarche commerciale non contestée.
La cour rejette également l'argument du musée sur le devoir d'information au public (quelle était la nécessité ?) et relève au contraire sa négligence en ne procédant à aucune recherche sur la licéité des œuvres exposées eu égard à la « réputation sulfureuse » de l'artiste, ce qu'il ne pouvait ignorer. Cette négligence allant d'ailleurs jusqu'à accepter l'absence de toute clause de garantie dans le contrat d'exposition conclu avec l'artiste, et lui valant ainsi d'être poursuivi non pas à une mais deux reprises à l'occasion de la même exposition. Le jugement a donc été confirmé mais la cour a alourdi le quantum du préjudice calculé par le tribunal (274 000 € tous préjudices confondus y compris article 700 du code de procédure civile ; sauf pour le musée qui voit sa quote-part de participation aux dommages et intérêts passer de 20 % à 10 %).
Peut-être aurait-il été finalement moins onéreux de solliciter l'autorisation de l'auteur. D'autant que si la démocratisation de l'art prônée par Jeff Koons pour toucher le plus grand nombre est une démarche noble en soi, elle ne doit pas conduire à affaiblir le droit d'auteur et par conséquent les auteurs eux-mêmes. Cela aurait au contraire pour conséquence de rendre l'art élitiste, avec une offre culturelle proposée exclusivement par des artistes privilégiés. Cette diversité artistique ne peut se maintenir que si les auteurs perçoivent effectivement une rémunération en contrepartie de l'utilisation de leur travail, leur permettant ainsi de continuer à créer.




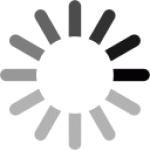
 S'abonner à Legipresse
S'abonner à Legipresse Feuilleter le dernier numéro
Feuilleter le dernier numéro