(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Vidéos
La liberté d'information à l'épreuve du secret défense
Huit journalistes ont été convoqués par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) au cours des derniers mois ; sept d'entre eux pour « compromission du secret de la défense nationale », infraction prévue par l'article 413-11 du code pénal. Que leur vaut d'être entendus dans ce bâtiment ultra-sécurisé aux allures de Bureau des Légendes ? Il leur serait reproché une enquête sur les armes françaises employées contre les populations civiles au Yémen et, plus particulièrement, la détention et la publication d'un document classifié « secret défense » évoquant l'utilisation de ces armes par l'Arabie Saoudite(1).
Ces convocations en cascade ont suscité émoi et interrogation sur le traitement des journalistes par le pouvoir, déjà contesté pour l'adoption de lois sur le secret des affaires et les fake news. La liberté d'information serait-elle ainsi réduite à peau de chagrin par le sacro-saint « secret défense » et les journalistes seraient-ils des citoyens comme les autres ?
Un durcissement de la loi a été évoqué ici et là. Rien de tel dès lors que les dispositions qui fondent cette enquête sont issues d'une loi de 1994, modifiée en 2009, ce texte définissant les atteintes au secret de la défense nationale et introduisant une distinction selon la qualité de l'auteur de la divulgation.
L'article 413-9 du code pénal prévoit ainsi que « présentent un caractère de secret de la défense nationale les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatisés ou fichiers intéressants la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou accès ». Et l'article 413-10 sanctionne la violation de ce secret par la personne qui en est le dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction, d'une mission temporaire ou permanente, tandis que l'article 413-11 vise toute autre personne et incrimine le fait de « 1° S'assurer la possession, accéder à, ou prendre connaissance d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ; 2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier ; 3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier ».
Ainsi, le fait de détenir ou d'avoir pris connaissance d'un document classifié secret-défense et a fortiori le fait de le diffuser par voie de presse sont répréhensibles, de sorte que le journaliste qui détiendrait un tel document ou une simple information relevant du secret défense pourrait être poursuivi sur ce fondement, quand bien même rien ne serait publié.
L'arrêté ministériel du 30 novembre 2011 sur la protection du secret de la défense nationale précise que « L'infraction de compromission est constituée même si la divulgation n'est pas réalisée mais seulement rendue possible ».
A l'évidence, la simple détention par une entreprise de presse ou un journaliste rend la divulgation possible et, à tout le moins, envisageable au sens de cet arrêté et est donc susceptible de caractériser la « compromission ».
Le champ d'application de l'article 413-11 est donc singulièrement vaste et entrave considérablement, en théorie les enquêtes des journalistes.
Cette limite est d'autant plus forte que cet arrêté précise, d'une part, que « la protection pénale est limitée aux informations ou supports faisant l'objet d'une mesure de classification. Tant que cette classification perdure, quelle qu'en soit l'ancienneté ou la pertinence, le délit de compromission conserve sa pleine application » et, d'autre part, et c'est même le principe qui préside à l'organisation de la protection, « la protection du secret concerne tous les domaines d'activité relevant de la défense et de la sécurité nationale : politique, militaire, diplomatique, scientifique, économique, industriel ».
Le secret défense relève donc d'un immense amalgame d'informations hétéroclites, toutes protégées au nom de l'intérêt supérieur de la France, et auxquelles il serait donc interdit de s'intéresser par principe, les journalistes ne bénéficiant pas de garanties spécifiques et étant, au sens de ces textes, des justiciables comme les autres.
Est-ce à dire que la liberté de l'information s'efface totalement devant le secret défense au nom de la raison d'État et, pour reprendre la distinction de Jean Lacouture(2), que « l'intérêt public » éclipse « l'intérêt du public » à être informé ? Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité à l'heure de la transparence : « Reste-t-il des sphères du pouvoir à maintenir à l'abri des regards. Quels secrets d'État nos sociétés sont-elles encore capables de tolérer ? »(3) ; ou tous les pans de nos démocraties doivent-ils être traversés par la lumière pour éclairer les citoyens ?
« Briser un secret d'État est toujours une affaire délicate reposant sur un équilibre entre deux principes tout aussi légitimes, en l'occurrence la liberté d'informer et les impératifs de sécurité nationale »(4). Il faut donc arbitrer entre ces deux légitimités et la Cour européenne des droits de l'homme veille à trouver le juste équilibre.
La liberté d'expression, garantie par la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas absolue et peut connaître des restrictions prévues par la loi, tenant notamment à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique (art. 10, § 2).
Si la Cour l'a rappelé dans un arrêt du 26 juin 2018, elle a pourtant retenu la violation de l'article 10 par la Roumanie pour avoir condamné un journaliste ayant révélé des informations classées secret défense : « l'article 10 de la Conv. EDH laisse peu de place aux restrictions à la liberté d'expression dans deux domaines, à savoir les discours politiques et les questions d'intérêt public. En conséquence, un niveau élevé de protection de la liberté d'expression, les autorités disposant ainsi d'une marge d'appréciation particulièrement étroite, sera normalement accordé lorsque les remarques concernent une question d'intérêt public. Toutefois, la protection accordée par l'article 10 aux journalistes est subordonnée à la condition qu'ils agissent de bonne foi afin de fournir des informations exactes et fiables conformément aux principes du journalisme responsable. La notion de journalisme responsable, en tant qu'activité professionnelle protégée par l'article 10, ne se limite pas au contenu des informations recueillies et/ou diffusées par des moyens journalistiques. Cette notion englobe également la licéité du comportement du journaliste et le fait qu'un journaliste ait enfreint la loi est une considération pertinente mais non décisive pour déterminer s'il a agi de manière responsable. »
Elle a ensuite estimé que s'agissant de questions d'intérêt public, les informations révélées avaient déjà fuité, étaient obsolètes et ne mettaient pas en péril la sécurité nationale, ces informations n'ayant pas été recueillies par des moyens illicites et le journaliste les ayant divulguées dans le cadre d'une enquête l'ayant notamment conduit à interroger l'autorité dont émanaient les documents(5).
Se dégage donc la notion d'un « journalisme responsable », tant dans la démarche formelle d'obtention de l'information que dans le contenu de celle-ci.
Le juge français n'a, semble-t-il, pas encore eu à pratiquer cet exercice d'équilibrisme. Deux affaires peuvent néanmoins être mentionnées. Dans la première, un journaliste avait publié une note de synthèse de la DGSE dans le journal Le Monde, le 18 avril 2007, ce qui avait entraîné une perquisition à son domicile, une garde à vue et sa mise en examen pour avoir divulgué des informations confidentielles. Ce journaliste a bénéficié d'un non-lieu le 6 janvier 2014, les magistrats instructeurs soulignant que « la façon dont la DST a essayé d'identifier la “source” de Monsieur Guillaume D. pose problème dans ce dossier »(6).
Plus récemment, le 2 octobre 2016, le parquet de Paris signifiait un simple rappel à la loi à deux journalistes, à l'issue d'une procédure ouverte pour compromission du secret de la défense nationale, suite à la publication, dans l'édition du 24 août 2016 du Monde, d'un document détaillant un plan d'attaque de la Syrie par la France, jamais exécuté. François Molins, ex-procureur de la République de Paris, leur indiquait ainsi que l'enquête de la DGSI avait « permis de caractériser une compromission du secret de la défense nationale » et les sensibilisait au « nécessaire respect des règles de protection des informations classifiées. »
À cette occasion, le ministre de la défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian, relativisait cette fuite qu'il analysait comme « la publication dans un journal du soir d'éléments (…) sur des événements qui remontent à trois ans et en plus une opération qui n'a pas eu lieu »(7). Le même Jean-Yves Le Drian, désormais ministre des Affaires étrangères, déclare, à propos des convocations de la DGSI : « il y a des documents classifiés (confidentiel ou secret défense) et toute personne non habilitée à en avoir la possession est soumise à une poursuite judiciaire systématiquement. Ça fait partie de la manière dont l'État doit fonctionner, et s'il n'y a plus de secret défense ou de documents classifiés pour assurer la sécurité de notre pays, alors on va dans une situation extrêmement compliquée (…). Ce n'est pas une chasse aux journalistes »(8).
Ce n'est pas une chasse aux journalistes, peut-être, mais c'est assurément une forme d'intimidation et une chasse à leurs sources, au mépris de l'article 2 de la loi de 1881.
Il y a donc lieu de déterminer si le secret entourant le document qui concentre aujourd'hui les attentions de la DGSI méritait d'être brisé. C'est la question que se sont certainement posée les journalistes et leur source et que se posera une juridiction si elle est saisie. Il lui incombera d'arbitrer entre l'information du public sur un sujet légitime d'une opacité pourtant totale – l'utilisation d'armes françaises dans un conflit devenu catastrophe humanitaire – et la préservation des intérêts de l'État dont on a peine à penser qu'il pourrait s'agir de la préservation de ses simples intérêts commerciaux en matière de vente d'armes.
L. G.




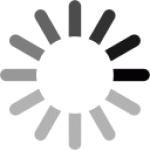
 S'abonner à Legipresse
S'abonner à Legipresse Feuilleter le dernier numéro
Feuilleter le dernier numéro