(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Un avocat peut-il tout dire ?
Un avocat dans l'exercice de ses fonctions de défenseur peut tout dire, ou presque, car la liberté de parole de l'avocat est une garantie de l'ordre public de la justice. Cette liberté est un élément fondamental du procès équitable qui ressort à son indépendance. Comme le journaliste, il est un contrepouvoir institutionnel. La liberté d'expression du barreau est donc aussi précieuse que celle de la presse.
Cette liberté n'est toutefois pas sans limite. Comme toute liberté, elle est encadrée et limitée lorsqu'on en abuse. Mais pour éviter l'arbitraire, il faut que l'abus soit prévu par la loi, selon la mécanique constitutionnelle de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le juge ne peut donc sanctionner un avocat qui a abusé de sa liberté de parole qu'en application de la loi. Or, ça tombe bien, c'est précisément la loi sur la liberté d'expression, celle du 29 juillet 1881 qui règle la question. Son article 41 pose le principe de l'immunité du discours judiciaire, c'est-à-dire le principe d'une totale liberté. Cet article prévoit, à ses deux derniers alinéas, deux aménagements qui sont les seuls susceptibles de restreindre cette immunité. Il offre ainsi, à son dernier alinéa, aux parties le droit de poursuivre des propos diffamatoires « étrangers à la cause », pour autant qu'ils aient été « réservés » auprès du greffier. La condition d'extranéité s'entend très strictement par la jurisprudence(1). Il faut que les propos ne puissent en rien se rattacher au dossier ou à l'exercice des droits de la défense, lesquels supposent parfois des digressions(2).
En outre, pour éviter qu'une audience devant une juridiction ne dégénère, le président de celle-ci dispose d'un pouvoir de police, consistant à rappeler à l'ordre les auteurs de débordements, et celui de suspendre l'audience pour régler les incidents. Ceux-ci ne sont pas rares. Lorsqu'un avocat se voit rappelé à ses devoirs, le président en appelle alors au bâtonnier ou à son représentant, car il s'agit d'obligations de nature déontologiques, lesquelles ne dépendent que de l'imperium du bâtonnier. C'est une des autres garanties de l'indépendance des barreaux. C'est ainsi que cela fonctionne. Et si l'avocat a effectivement commis une faute au regard de la loi comme de sa déontologie, il est le seul à en répondre. Ces fautes ne peuvent pas être imputées à son client, quand bien même il en est le mandataire.
La « victimisation secondaire » qui peut résulter de la rudesse des étapes de la procédure pénale pour les victimes, en particulier celles de viols ou d'agression sexuelle, mérite toutes les attentions et reconnaissances. Pour autant, elle ne saurait inférer sur le périmètre ainsi posé de la liberté de parole de l'avocat. À cet égard, il ne saurait appartenir au juge saisi de la cause d'en fixer les contours selon les critères de ce qui serait « strictement nécessaire à la manifestation de la vérité » ou « à l'exercice légitime des droits de la défense »(3). Ces critères sont par nature subjectifs. Et ils ressortent exclusivement à la conscience de l'avocat, lequel est le seul dépositaire de l'exercice des droits de la défense ; et ce, dans les limites sus-rappelées posées par la loi.



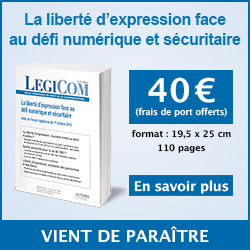
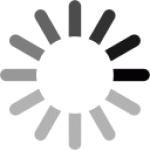
 S'abonner à Legipresse
S'abonner à Legipresse Feuilleter le dernier numéro
Feuilleter le dernier numéro