(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Vidéos
La lutte contre l'antisémitisme et la loi de 1881
Les Assises de la lutte contre l'antisémitisme viennent de rendre leur rapport(1). Constatant « l'explosion des infractions à caractère antisémite », la mission propose plusieurs mesures visant à enrichir la loi pour rendre leurs poursuite et répression plus efficaces. Le rapport propose ainsi que la loi réprime non plus seulement les provocations « directes » aux discriminations, mais aussi celles « indirectes », qu'elle élève le quantum des peines applicables, afin notamment que les juridictions et parquets puissent délivrer des mandats d'arrêt ou de dépôt. La mission appelle aussi de ses vœux la création d'un sursis probatoire et l'édiction de peines de confiscation. La question récurrente de la sortie des incriminations réprimant le discours raciste de la loi sur la presse s'est évidemment invitée aux débats. Mais elle n'a pas été tranchée par les membres de la commission. C'est une originalité du rapport qui se contente de rapporter les arguments pour et contre cette sortie.
La volonté politique exprimée de modifier la loi augure d'un nouveau chantier législatif. Espérons que les arguments avancés par les tenants de la conservation de ces incriminations dans la loi du 29 juillet 1881 sauront se faire entendre. On ne le redira jamais assez, la loi de 1881 n'est pas le problème en la matière, mais la solution. Depuis la loi Pleven de 1972, l'expression publique de l'antisémitisme est parfaitement incriminée par les infractions de la loi de 1881, y compris dans ses formes les plus insidieuses, comme lorsqu'il s'exprime sous les oripeaux de l'antisionisme. Retirer la répression du discours raciste de la loi de 1881 créerait une situation très aléatoire et imprévisible, dans laquelle un juge de droit commun qui ne serait plus encadré par les garanties de la loi de 1881 pourrait prendre les décisions les plus inattendues. La seule fois où le législateur a fait le choix de sortir une incrimination de la loi, ce fut pour mettre le délit d'apologie et de provocation au terrorisme dans le code pénal(2). Or, cette disposition, dont le champ d'application est pourtant très restreint, a donné lieu à des décisions arbitraires, imprévisibles et même souvent rocambolesques. Il suffit pour s'en convaincre de lire ce qu'en a dit le Défenseur des droits lorsqu'il a tiré le bilan de cette loi d'exception : « La mise en œuvre de la loi de novembre 2014, sur le délit d'apologie et de terrorisme, a conduit à un fiasco judiciaire »(3).
Pour distinguer l'opinion licite du message raciste, il faut parfois beaucoup de science et de précaution. La frontière entre les deux n'est pas toujours aisée à tracer. Le procès des caricatures de Charlie Hebdo n'a pu se tenir de façon aussi exemplaire que parce qu'il a obéi aux règles du droit de la presse et fut tranché par la chambre de la presse du tribunal. Loin de donner satisfaction à ceux qui clament à raison que « le racisme n‘est pas une opinion », la sortie de la loi de 1881 aboutirait à la situation inverse de celle qu'ils appellent de leurs vœux. On verrait les formes les plus contemporaines de l'antisémitisme passer entre les gouttes. À l'inverse, cela exposerait n'importe quelle critique se rapportant très indirectement à une religion, comme la dénonciation de certains fondamentalismes terroristes, à être considérée comme du racisme. Tout serait permis. Et les lobbys judiciaires auraient tôt fait de qualifier de raciste ce qui ne l'est pas, précisément pour échapper aux garanties de la loi de 1881 !



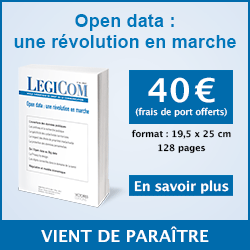
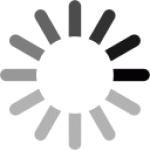
 S'abonner à Legipresse
S'abonner à Legipresse Feuilleter le dernier numéro
Feuilleter le dernier numéro