(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Les 2 derniers inscrits
Vidéos
Droit des marques (Octobre 2020 - Octobre 2021)
Comme chaque année, l'actualité du droit des marques se veut particulièrement riche. Le présent panorama se propose de revenir sur des décisions qui auront marqué la matière au cours des douze derniers mois. Il y est notamment question de l'importance de la description pour les marques consistant en une combinaison de couleurs, de mauvaise foi, de l'appréciation et des effets de la déchéance pour défaut d'exploitation, de l'appréciation du vice de déceptivité et du risque de confusion ou encore de l'hypothèse d'une marque déposée par un agent ou un représentant, en son nom propre.
Auteurs : Yann Basire, Marie-Sophie Bergazov, Clémence de Marassé-Enouf, Chloé Piedoie, Maëlle Sengel, Romain Soustelle
I - Actualité européenne du droit des marques
A - Existence du droit de marque
1 - Motifs absolus
Représentation du signe : importance de la description. L'arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 24 mars 2021(1) revient sur l'importance de la description des marques consistant en une combinaison de couleurs juxtaposées, sans formes ni contours.
La société Stihl avait sollicité, en 2008, l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, consistant en une combinaison des couleurs orange et grise (IMAGE1) afin de désigner des tronçonneuses. La combinaison de couleurs était, par ailleurs, associée à la description suivante : « La partie supérieure du boîtier de la tronçonneuse est orange et la partie inférieure du boîtier de la tronçonneuse est grise ». Enregistrée en 2011, la validité de la marque fut toutefois contestée dans le cadre d'une action en nullité introduite en 2015. Il était reproché à cette marque de ne pas respecter l'exigence de représentation graphique, tirée de l'article 4 du règlement (CE) no 40/94, en vigueur au moment du dépôt de la marque en cause. La division d'annulation rejeta cette demande. La décision fut toutefois infirmée par la chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) aux motifs que la représentation graphique de la marque ne faisait pas apparaître un agencement systématique des couleurs et que la description n'était pas suffisamment claire et précise.
Saisi du recours contre cette décision, le Tribunal de l'Union européenne rappelle, dans un premier temps, que l'exigence de clarté et de précision des signes enregistrés à titre de marque servait à garantir la sécurité juridique des tiers en leur permettant de déterminer l'objet de la protection accordée. Pour cette raison, la représentation graphique de deux couleurs, sans formes ni contours, doit comporter un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante(2). Le Tribunal précise, en outre, qu'un échantillon de couleurs accompagné d'une description peut constituer une représentation graphique de la marque, la description devant être « claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible et objective »(3).
En l'espèce, en examinant conjointement la combinaison de couleurs et la description, le Tribunal estime que la représentation graphique de la marque en cause n'est pas une simple juxtaposition de couleurs dépourvue d'agencement systématique. La description, en prévoyant que la marque prendra la forme des produits désignés et que leur partie supérieure sera orange et leur partie inférieure grise, empêche que les couleurs ne prennent « toutes les formes imaginables »(4). Cette description permet ainsi de caractériser un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante(5). La marque n'étant pas dépourvue de précision et de constance, le Tribunal annule, en conséquence, la décision de la chambre de recours de l'EUIPO. Par ailleurs, il estime que le consommateur pertinent, grâce à la description, saura associer cette combinaison de couleurs à la marque en question et à ses produits de manière à pouvoir réitérer une expérience d'achat(6).
R. S.
Appréciation de la mauvaise foi. La notion de mauvaise foi n'étant pas définie par les textes européens, son appréciation et sa caractérisation résultent des préceptes dégagés par la Cour de justice. L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 21 avril 2021(7) s'inscrit, ainsi, dans la lignée des arrêts Koton(8) et Skykick(9), rendus respectivement sur pourvoi et question préjudicielle sur le sujet.
La société Hasbro (ci-après Hasbro) a procédé, en 2010, au dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque verbale de l'Union européenne MONOPOLY no 9071961, enregistrée en 2011 pour désigner des produits en classe 9, 16, 28 et 41 et, notamment, des « jeux d'arcade ; logiciels de divertissement ; jeux électroniques ; logiciels de jeux vidéo ; papier et carton et produit en ces matières ; produits d'imprimerie : jeux, jouets ; cartes de jeux ; éducation ; formation ; divertissement ». Ce dépôt fut opéré à la suite de trois autres dépôts de marques verbales identiques, enregistrées successivement en 1998, 2009 puis 2010 pour désigner des produits identiques, similaires ou différents en classe 9, 16, 25, 28, et 41.
En 2015, la société croate Kreativni Dogadaji d.o.o. demanda la nullité de la marque MONOPOLY no 9071961 pour mauvaise foi, en ce que le dépôt de cette marque aurait été effectué dans le seul dessein de se soustraire à l'obligation de rapporter la preuve d'un usage sérieux, dans le cadre, notamment, des procédures d'opposition. Cette action en nullité fut, en premier lieu, rejetée par la division d'annulation avant d'être accueillie par la chambre de recours. L'affaire fut, ensuite, portée devant le Tribunal de l'Union européenne qui statuera sévèrement sur la pratique des dépôts réitérés.
Dans un premier temps, le Tribunal indique que l'EUIPO peut, lorsqu'il constate des circonstances objectives du cas d'espèce, renverser la présomption de bonne foi du titulaire de la marque dont la nullité est demandée. Il appartenait dès lors à Hasbro d'éclairer l'Office sur les intentions ayant guidé ce dépôt de marque. De là, l'aveu sincère de la société Hasbro, lors d'une audience devant la chambre de recours, lui coûta sa marque de l'Union européenne MONOPOLY.
En effet, la société requérante avoua, à cette occasion, que la stratégie consistant à réitérer une demande d'enregistrement d'une marque identique, pour désigner des produits et services déjà couverts par des marques antérieures, avait été menée, notamment, afin de réduire sa charge administrative induite par l'obligation de rapporter la preuve de l'usage sérieux de ses marques antérieures dans le cadre d'une opposition. Ainsi, comme le relève le Tribunal, si le fait de réitérer un dépôt d'une demande d'enregistrement de marque identique n'est pas révélateur en lui-même de la mauvaise foi du titulaire, il est apparu que les éléments du dossier démontraient que Hasbro avait « délibérément visé à contourner une règle fondamentale du droit des marques de l'Union européenne, à savoir celle relative à la preuve de l'usage, pour en tirer profit au détriment de l'équilibre du régime des marques de l'Union européenne établi par le législateur de l'Union ». Cette stratégie de dépôt permettait, non seulement de ne pas avoir à rapporter la preuve de l'usage sérieux de la marque contestée, mais aussi de prolonger artificiellement le délai de grâce de cinq ans prévu à l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 pour les marques antérieures MONOPOLY. En détournant les règles du droit des marques à son profit, la société Hasbro use, selon le Tribunal, d'une pratique rappelant la « figure de l'abus de droit ».
Hasbro tente de se sortir de cette impasse et de légitimer sa manœuvre en invoquant le fait que cette stratégie était une pratique industrielle largement connue et usitée par les entreprises. L'argument est strictement rejeté par le Tribunal qui considère que « le simple fait que d'autres entreprises puissent recourir à une certaine stratégie de dépôt ne rend pas nécessairement cette stratégie légale et acceptable ». Partant, la marque MONOPOLY fut partiellement annulée sur le fondement de la mauvaise foi pour les produits déjà couverts par les marques identiques précédemment enregistrées par Hasbro. Retenons que la décision rendue à l'encontre de la société Hasbro peut paraître sévère, alors que les dépôts réitérés ne concernaient, en l'espèce, que quatre marques identiques et que l'on sait que, effectivement, il s'agit d'une pratique connue des entreprises qui en font parfois une utilisation bien plus excessive. S'il ne fait guère de doute qu'Hasbro paye ici sa maladresse, il n'en demeure pas moins que la décision tend à démontrer une fois de plus que la notion de mauvaise de foi est appréhendée de plus en plus largement.
C. P.
2 - Motifs relatifs
Marque déposée par un agent. L'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 sur la marque de l'Union européenne vise, au titre des motifs relatifs de refus et de nullité, l'hypothèse d'une marque demandée à l'enregistrement par l'agent ou le représentant du titulaire de celle-ci, en nom propre et sans le consentement du titulaire. L'objectif d'une telle disposition est d'empêcher l'agent ou le représentant d'exploiter les bénéfices tirés de sa relation commerciale avec le titulaire, ainsi que de profiter indûment des investissements consacrés par celui-ci sur sa marque. Rendu sur pourvoi, l'arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2020 est venu préciser la portée de cette disposition, tant s'agissant de la notion d'agent ou de représentant, que s'agissant de son applicabilité aux dépôts portant sur des marques similaires.
La société John Mills a déposé la marque de l'Union européenne MINERAL MAGIC. Une opposition a alors été formée par la société Jerome Alexander Consulting, titulaire d'une marque américaine antérieure MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER. L'opposition fut, dans un premier temps, rejetée. La solution fut toutefois infirmée par la chambre de recours de l'EUIPO, dont la décision fut, à son tour, annulée par le Tribunal de l'Union européenne. Saisie à la suite d'un pourvoi formé par l'EUIPO, la Cour de justice vient trancher, définitivement, le litige au fond en censurant l'arrêt rendu par le Tribunal.
La Cour note que l'interprétation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement implique de le lire à la lumière des travaux préparatoires de l'article 6 septies de la convention de Paris et de tenir compte du contexte dans lequel il s'inscrit, mais aussi de l'objectif précité qu'il poursuit – à savoir éviter le détournement de la marque antérieure par l'agent ou le représentant du titulaire de celle-ci. La Cour de justice estime ainsi que le titulaire de la marque antérieure doit pouvoir s'opposer à l'enregistrement d'une marque demandée par son agent ou son représentant sans son consentement, qu'elle soit identique ou similaire à sa propre marque. De l'avis de la Cour, exiger l'identité entre les marques en conflit nuirait à l'économie générale du règlement et à l'objectif porté par cette disposition. Le détournement de la marque du titulaire peut, en effet, se produire même lorsque les marques sont seulement similaires.
S'agissant de la qualité d'agent, la Cour relève que les notions d'agent et de représentant du titulaire doivent être entendues largement. La qualité d'agent peut être déduite d'une relation contractuelle de nature à créer une relation de confiance entre les parties, notamment une obligation de loyauté de l'agent à l'égard du titulaire. En l'espèce, au regard des éléments du contrat de distribution liant le titulaire au déposant, ce dernier est bien agent du titulaire.
En outre, en réaffirmant par la suite que l'article 8, paragraphe 3, du règlement s'applique « tant lorsque la marque demandée est identique à [la] marque antérieure que lorsqu'elle lui est similaire », la Cour précise qu'il s'applique également lorsque les produits et services désignés par la demande d'enregistrement et ceux couverts par la marque antérieure sont identiques ou similaires. La Cour estime que la similitude entre les marques en conflit aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 ne s'apprécie pas en fonction de l'existence d'un risque de confusion, cette condition étant propre à l'article 8, paragraphe 1, sous b). Les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 3, se limitent ainsi au fait que l'agent ait déposé la marque en son propre nom, sans consentement du titulaire et sans justification.
R. S.
Appréciation in abstracto du risque de confusion. Le Tribunal de l'Union européenne, par un arrêt du 21 avril 2021, est venu rappeler que l'appréciation du risque de confusion, dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de nullité, doit se faire in abstracto. Dès lors, les marques en conflit doivent être comparées dans leur forme, telle qu'enregistrée, et ce « indépendamment de toute éventuelle rotation lors de leur utilisation sur le marché ». L'affaire opposait la société Huawei (ci-après Huawei) à la société Chanel (ci-après Chanel). Huawei avait, en effet, déposé, le 26 septembre 2017, une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne pour le signe figuratif suivant (IMAGE2), consistant en « un cercle contenant deux courbes ressemblant à l'image de deux lettres “u” de couleur noire disposées verticalement et en miroir inversé, qui se croisent et se coupent pour former un élément central constituant une ellipse horizontale ». Chanel forma alors une opposition, en invoquant deux marques françaises semi-figuratives, l'une prétendument renommée (IMAGE 3) et l'autre enregistrée en classe 9 (IMAGE 4) , consistant en « un cercle contenant deux courbes ressemblant à l'image de deux lettres “c” de couleur noire disposées horizontalement et en miroir inversé, qui se croisent et se coupent pour former un élément central constituant une ellipse verticale ».
La division d'opposition de l'EUIPO, puis la chambre de recours rejetèrent l'opposition. Chanel forma alors un recours devant le Tribunal de l'Union européenne, en reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la potentielle rotation à 90 degrés de la marque litigieuse, ayant pour conséquence de renforcer de manière significative la similitude visuelle des signes en conflit et d'aboutir au constat d'un risque de confusion du fait de ce simple élément, les signes ne pouvant faire l'objet d'une comparaison phonétique, étant dénués d'éléments verbaux, et ne renvoyant à aucun concept. Le Tribunal ne fait toutefois pas droit à cette demande et confirme en cela l'analyse retenue par la chambre de recours de l'EUIPO. Il expose que, lors de l'appréciation de l'identité ou de la similitude des signes, ceux-ci doivent être comparés dans la forme de leur enregistrement ou demande d'enregistrement et, partant, uniquement sur la base de l'orientation de signes tels que déposés. S'agissant de la marque (IMAGE 4), le tribunal procède à une comparaison des signes en conflit et conclut que « les marques en conflit sont différentes sur le plan visuel, en dépit de la présence commune de deux courbes entrelacées au sein d'un cercle de couleur noire ». S'agissant ensuite de la comparaison conceptuelle, la juridiction rejette les arguments de la demanderesse et expose que le signe antérieur renvoie aux initiales de Coco Chanel, tandis que le signe litigieux renvoie à la lettre « h » de Huawei stylisée, ou à deux « u » entrelacés, celles-ci se différenciant d'un point de vue conceptuel. La même comparaison est effectuée pour le second signe, aboutissant, sans surprise, au rejet de la demande d'opposition.
C. d. M.-E.
B - Exercice du droit de marque
Déchéance pour défaut d'usage sérieux. La Cour de justice de l'Union européenne, saisie par voie de question préjudicielle par le tribunal régional supérieur de Düsseldorf, s'est prononcée sur le mécanisme de déchéance pour défaut d'exploitation, dans une décision en date du 22 octobre 2020. Le litige opposait la société DU, ayant introduit en 2015 une demande en déchéance des marques Testarossa enregistrées en Allemagne et par voie internationale, respectivement en 1987 et 1990, qui désignaient inter alia les « véhicules et leurs parties » en classe 12, à la société Ferrari Spa (Ferrari), titulaire des marques en question. Le tribunal régional supérieur de Düsseldorf, saisi après que Ferrari eut interjeté appel contre la décision de radiation des marques par le tribunal régional de Düsseldorf, s'interrogeait sur l'interprétation de certains points opérée par la juridiction de première instance. Au titre des faits pertinents à l'affaire, la juridiction de renvoi relevait que Ferrari avait commercialisé des modèles de voiture Testarossa entre 1984 et 1990 et, qu'à la suite de l'arrêt de la production, la société avait toutefois continué à proposer des services d'entretien, ainsi qu'à vendre des pièces détachées et accessoires à destination de ces modèles. En sus de ces services, Ferrari organisait également un circuit de distribution de véhicules d'occasion dont elle assurait elle-même la vérification et la certification.
Au regard des faits de l'espèce et des dispositions applicables, le tribunal régional supérieur posait six questions à la Cour de justice, pouvant être regroupées en trois points de droit. Le premier concernait les caractères de l'usage sérieux de l'article 12, paragraphe 1, de la directive no 2008/95/CE, aujourd'hui article 19 de la directive no 2015/2436/UE. Le deuxième avait trait à la compatibilité entre le droit de l'Union européenne et une convention bilatérale, prévoyant que l'usage sur le territoire d'un État partie vaut également usage sur le territoire de l'autre État. Pour finir, la dernière question portait sur la partie au litige devant supporter la charge de la preuve de l'usage sérieux.
Le Tribunal régional supérieur de Düsseldorf posait, dans un premier temps, la question de savoir si les actes précités de Ferrari pouvaient valoir usage sérieux au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive no 2008/95/CE et si, le cas échéant, une sous-catégorie autonome de produits pouvait être distinguée au sein de la catégorie des « véhicules », dès lors que l'usage se restreignait à un segment spécifique du marché, à savoir celui des voitures de sport de luxe coûteuses. La présente décision de la Cour de justice se place dans la lignée de l'arrêt Ansul qui avait dégagé le principe selon lequel l'usage sérieux pour des produits déjà commercialisés et qui ne font plus l'objet de nouvelles offres de vente, est susceptible d'être caractérisé si des pièces détachées ou accessoires identifiés par la même marque entrant dans leur composition ou structure continuent d'être commercialisés. Ainsi, l'usage pour des pièces détachées et accessoires profite aux produits auxquels ils sont destinés, sous réserve de l'utilisation effective de la marque concernée. En toute logique, la Cour applique le même raisonnement et principe aux services connexes, tels que les services de réparation et d'entretien. Sur la question de la possibilité pour des voitures de sport de luxe coûteuses de constituer une sous-catégorie autonome de produits, la Cour répond par la négative. En effet, la notion de « segment spécifique du marché » n'est pas pertinente dans l'identification de sous-catégories autonomes, en ce qu'elle s'appuie sur un élément, la spécificité du marché, qui ne relève pas des critères pertinents de la destination et finalités des produits. Par conséquent, la catégorie des véhicules et ses parties n'étant pas subdivisible au profit d'une sous-catégorie correspondant aux voitures de sport de luxe et coûteuses, l'usage sérieux pour les pièces détachées et accessoires vaut pour l'ensemble de cette catégorie.
L'apport le plus significatif de cet arrêt tenait au fait que la Cour de justice devait se prononcer sur la capacité des actes de revente de produits déjà commercialisés – en d'autres termes la vente de produits d'occasion – à constituer un usage sérieux. Relevant que l'utilisation d'une marque lors de la revente de produits d'occasion peut être faite en adéquation avec la fonction essentielle d'identité d'origine, la Cour de justice consacre le principe selon lequel de tels actes peuvent valoir usage sérieux. Elle rejette, par conséquent, la position de la juridiction allemande de première instance qui, raisonnant par analogie avec l'épuisement des droits, excluait la qualification d'usage sérieux pour des actes de revente de produits déjà commercialisés. Il appartiendra ainsi à la juridiction allemande de renvoi de déterminer l'étendue du rôle endossé par Ferrari dans le réseau de distribution de ses véhicules d'occasion.
La cinquième question du Tribunal régional supérieur de Düsseldorf portait sur la compatibilité d'une convention bilatérale conclue entre l'Allemagne et la Suisse, prévoyant que l'usage d'une marque enregistrée dans l'un des deux États devait être pris en considération afin de déterminer l'usage sérieux sur le territoire de l'autre État, avec les dispositions européennes relatives à la déchéance des droits de marque. Relevant que l'article 12 de la directive no 2008/95/CE, aujourd'hui article 19 de la directive no 2015/2436/UE, fait mention de l'usage « fait dans l'État membre concerné », la Cour soulève l'incompatibilité de la Convention bilatérale avec ce principe de territorialité. Au regard de l'article 351 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en vertu duquel un État est autorisé à maintenir ses droits et obligations issus de traités conclus avant 1958 ou conclus préalablement à son intégration à l'Union européenne, il reviendra à l'Allemagne de vérifier si une interprétation de la Convention conforme à la directive Marques est possible et, dans le cas contraire, de prendre toute mesure nécessaire pour neutraliser cette incompatibilité.
En dernier lieu, la juridiction allemande interrogeait la Cour de justice sur la possibilité d'exiger du demandeur en déchéance de rapporter la preuve d'absence d'usage sérieux. La Cour de justice, après avoir rappelé que les États demeuraient libres de fixer leurs propres règles en matière de procédure, et ce en vertu du considérant 6 de la directive no 2008/95/CE, exclut la charge de la preuve de la catégorie des règles de procédures. Une solution contraire entraînerait une protection à géométrie variable qui porterait atteinte à l'objectif d'harmonisation du droit de l'Union européenne fixé par le considérant 10 de la directive no 2008/95/CE. En outre, la charge de la preuve du titulaire est de « bon sens » et répond à un impératif élémentaire d'efficacité, en ce qu'un principe inverse imposerait au demandeur l'impossible devoir de démontrer un fait négatif.
M. S.
Date de l'usage sérieux. Les règlements sur la marque communautaire et la marque de l'Union européenne n'indiquent pas explicitement la date pertinente à prendre en compte afin de calculer la période quinquennale de non-usage en matière de demande en déchéance formée à titre reconventionnel. Il est ainsi revenu à la Cour de justice de combler le silence des textes afin de déterminer si les règles de droit national pouvaient se substituer sur ce point aux textes européens. Par un arrêt du 17 décembre 2020, les juges du plateau de Kirchberg, saisis par voie de question préjudicielle par la Haute juridiction allemande (Bundesgerichtshof), ont ainsi retenu qu'à l'occasion d'une demande reconventionnelle en déchéance d'une marque de l'Union européenne, la date pertinente à retenir pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans pendant laquelle l'absence d'usage du signe doit être observée est la date d'introduction de la demande en déchéance. L'article 55 du règlement (CE) no 207/2009 prévoit en effet que la période de référence doit être déterminée au moment de la demande ou, exceptionnellement, à une date antérieure – sans pour autant indiquer cette date. Autrement dit, aucune date postérieure à l'introduction de la demande n'est envisagée pour calculer la période de non-usage. Or le système allemand offre, notamment, la possibilité de retenir une date postérieure à la demande. Dès lors, cela permettrait d'introduire une action en déchéance – et de la voir prospérer – sans que les conditions de fond ne soient remplies à la date de cette demande, ce qui aurait pour conséquence de compromettre fondamentalement la philosophie du droit des marques harmonisé et le principe d'effectivité. La décision est heureuse. Une solution inverse aurait, au surplus, porté atteinte au caractère et aux effets unitaires de la marque de l'Union européenne sur le territoire de l'Union, et ce indépendamment de la souveraineté procédurale des États membres en matière de titres nationaux. De toute évidence et à l'avenir, les difficultés d'articulation des droits nationaux et européen devraient considérablement s'estomper en raison de l'alignement des systèmes.
M.-S. B.
II - Actualité française du droit des marques
A - Existence du droit de marque
Appréciation de la distinctivité extrinsèque. Le signe « Giant » enregistré à titre de marque pour désigner des « aliments, mets et plats préparés » et « en particulier des articles de fast-food » décrit une caractéristique des produits désignés et est, à ce titre, dépourvu de caractère distinctif. Il s’agit là du point final apporté par la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 janvier 2021, à la saga opposant Quick à Sodebo.
Les sociétés Quick restaurants et Quick France, respectivement titulaire et licenciée de la marque internationale Giant, enregistrée le 14 juin 2006 pour désigner des produits alimentaires et services de restauration en classes 29, 30 et 43, ont assigné en 2011 la société Sodebo en nullité de la marque Pizza Giant Sodebo sur le fondement de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire. Reconventionnellement, la société Sodebo demanda la nullité de la marque Giant pour défaut de distinctivité. En première instance, est prononcée la nullité de la partie française de la marque internationale Giant pour défaut de distinctivité. Partant, les demanderesses se virent déboutées de leur action. Ce jugement fut infirmé en appel. La cour d'appel prononça la nullité de la marque Pizza Giant Sodebo et condamna la société Sodebo pour concurrence déloyale et parasitaire. Sur pourvoi, la chambre commerciale du 8 juin 2017 censura l'arrêt d'appel au motif que « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque », peu important que la caractéristique désignée soit essentielle sur le plan commercial. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris confirma le jugement.
Les sociétés Quick formèrent toutefois un nouveau pourvoi, arguant de deux moyens, le premier issu de la distinctivité, le second issu de la concurrence déloyale et parasitaire. Au sujet de la distinctivité, la chambre commerciale maintient sa position et relève que, à la date du dépôt de la marque Giant, ce signe était « nécessairement compris par le consommateur francophone de produits alimentaires et en particulier d'articles de “fast food” comme signifiant géant », désignant alors une caractéristique des produits désignés, privant le signe de distinctivité extrinsèque. Elle rappelle par ailleurs que l'usage continu, intense et de longue durée d'un signe comme l'importance des investissements publicitaires ne lui confèrent pas automatiquement une distinctivité acquise par l'usage, ce signe n'étant pas « nécessairement apte » à remplir la fonction de garantie d'identité d'origine. L'arrêt d'appel fait néanmoins l'objet d'une cassation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif que le succès de l'action en responsabilité pour agissements parasitaires, ouverte également à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, n'est pas subordonné à l'existence d'un risque de confusion.
C. d. M.-E.
Déceptivité et action en revendication. L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 novembre 2020 annonce un nouveau rebondissement dans l'affaire Bébé Lilly.
Prince AK est auteur des paroles et co-auteur de deux chansons mettant respectivement en scène un enfant prénommé Lili et un autre répondant au nom de « Bébé Lilly ». En 2006, ces chansons firent l'objet de nombreux contrats de cession et d'édition avec la société Heben Music. La même année, un single regroupant les deux chansons était commercialisé par cette même société. Le 1er juin 2006, la société Heben Music déposa une demande d'enregistrement de marque verbale française Bébé Lilly no 06 3 432 222 pour désigner différents produits et services en classe 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 38 et 41 ainsi qu'une marque verbale internationale Bébé Lilly no 920 900 pour désigner différents produits et services en classe 9, 16 et 38.
L'affaire fut une première fois portée devant la Cour de cassation qui retint, sur le double fondement des articles L. 712-6 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, le caractère frauduleux du dépôt de la demande d'enregistrement des deux marques, ainsi que la déceptivité de ces dernières, en ce qu'elles pourraient amener le consommateur à réaliser un rapprochement fallacieux entre le signe et l'œuvre de l'auteur.
L'artiste fait, cette fois, grief à l'arrêt de la Cour d’appel de renvoi du 29 juin 2018 d'avoir rejeté sa demande de revendication pour dépôt frauduleux des deux marques Bébé Lilly, déposées sans son accord par la société Heben Music. La cour d'appel avait retenu à cet effet que le demandeur ne pouvait à la fois demander la nullité de ces marques en invoquant leur caractère déceptif et en demander le transfert dans son portefeuille, les deux actions étant logiquement inconciliables. Pour justifier ses demandes, l'artiste objectait que les marques françaises et internationales Bébé Lilly n'étaient pas intrinsèquement trompeuses. Il considérait que les marques étaient entachées de ce vice seulement en ce qu'elles avaient été déposées par une société tierce et que, de ce fait, le consommateur pouvait opérer un rapprochement fallacieux entre les produits exploités par cette société et ses activités artistiques. Rejoignant les arguments de l'auteur, la Cour de cassation retient, finalement, que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande sans rechercher si, justement, ce transfert des marques à l'artiste aurait permis de purger le vice de tromperie grevant les marques litigieuses.
L'artiste faisait également grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts. La cour d'appel estimait que le requérant ne bénéficiait pas d'une exclusivité sur ces termes qui pouvaient être utilisés par d'autres artistes et ne démontrait pas en quoi l'utilisation des marques litigieuses lui aurait causé un préjudice. À cet égard, la Cour de cassation considéra que la cour d'appel, bien qu'elle eût constaté que la société avait, en connaissance de cause et de façon déloyale, privé l'artiste de la possibilité d'exploiter paisiblement la dénomination « Bébé Lilly », elle n'avait pas tiré des conséquences légales de ses constatations.
C. P.
B - Exercice du droit de marque
Usage à titre de marque et contrat de sponsoring. Aux termes de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, un titulaire peut être déchu de ses droits sur sa marque s'il a cessé d'en faire usage pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter, au plus tôt, de la date d'enregistrement. Dès lors, afin d'échapper à la déchéance, il reviendra au titulaire d'apporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque, que cet usage résulte de ses propres faits ou de ceux de tiers ayant préalablement obtenu son consentement.
C'est sur cette question empirique des actes pouvant constituer un usage sérieux que la Cour d’appel de Nancy s'est prononcée, le 29 septembre 2020, dans un arrêt de renvoi. Les sociétés Intra-Presse et L'Équipe, respectivement titulaire et licenciée de la marque française L'ÉQUIPE no 96.654.944 enregistrée en 1996, ont assigné en 2011 la société Sport Co & Marquage, titulaire de la marque française semi-figurative (IMAGE 5) no 3 478 011 enregistrée en 2007, pour atteinte à la marque renommée et contrefaçon par imitation. C'est tout naturellement que la société Sport Co & Marquage a contre-attaqué en déposant une demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d'exploitation pour l'ensemble des produits visés en classe 25, 28 et 41. La juridiction de première instance a accueilli cette demande et prononcé, notamment, la déchéance des droits sur la marque L'ÉQUIPE pour les produits en classe 41. La déchéance fut confirmée et étendue aux produits de la classe 25 et 28 par la Cour d’appel de Colmar. Les Éditions P. Amaury, venant aux droits de la société Intra-Presse, suite à une opération de fusion-absorption, et L'Équipe ont, alors, formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, au regard des moyens soulevés par les demanderesses et des conclusions dans lesquelles L'Équipe indiquait être partenaire de la société Amaury Sport Organisation (ci-après « ASO »), filiale de la société Les Éditions P. Amaury, pour l'organisation de l'événement sportif les « 10 km L'ÉQUIPE », a cassé partiellement, pour motif insuffisant, l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il prononçait la déchéance pour les produits en classe 41.
Il incombait donc à la Cour d’appel de Nancy de déterminer, notamment, si l'utilisation de la marque L'ÉQUIPE pour désigner un événement sportif, à savoir la course à pied les « 10 km L'ÉQUIPE », pouvait valoir usage sérieux, au sens de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, pour les services désignés en classe 41, et, plus particulièrement, pour « les activités sportives et culturelles ». En d'autres termes, la juridiction de renvoi devait répondre à la question de savoir si l'utilisation du terme « L'Équipe » dans la dénomination de l'événement et tous documents y afférents consistait en un usage à titre de marque pour des activités sportives ou si cette utilisation s'apparentait plutôt à une action de communication publicitaire au profit, in fine, des services de presse de L'Équipe.
En l'espèce, la cour d'appel retient que le contrat conclu entre ASO et L'Équipe relevait d'un partenariat et non d'une licence de marque, tel qu'il ressortait des conclusions déposées par les sociétés demanderesses : « Les partenaires sportifs versent des sommes très importantes pour pouvoir associer leur marque à celle de l'événement sportif ». Ainsi, si dans le cadre d'un contrat de licence, le tiers fait usage de la marque dans le domaine de spécialité pour lequel elle a été enregistrée, le contrat de sponsoring se distingue en ce sens que le titulaire verse une contrepartie financière à l'organisateur afin d'assurer une visibilité auprès du public participant ou extérieur, pour les produits ou services qu'il offre effectivement au public. Pour illustrer son raisonnement, la cour d'appel cite le cas d'une compagnie d'assurances qui réaliserait un parrainage dans le cadre d'un événement sportif et qui, par ce biais, promouvrait ses produits et services d'assurance et non l'activité sportive per se. Dans cette logique, l'événement constitue, non pas la matérialité des produits et services du titulaire, mais simplement un vecteur, un support par le biais duquel ils sont évoqués. Partant, la cour d'appel conclut que l'utilisation du signe L'ÉQUIPE, dans le cadre de la course susmentionnée, s'inscrit dans une opération publicitaire pour les produits et services effectivement développés par le titulaire, à savoir les activités de presse et média, et ne vaut donc pas usage sérieux pour les activités sportives et culturelles désignées en classe 41, au sens de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.
M. S.
Conséquences de la déchéance. Toute atteinte à un droit de marque existant ouvre, a priori, droit à réparation. La question est toutefois plus épineuse lorsqu'il s'agit de demander réparation sur la base d'un droit de marque n’existant plus, du fait d'une action en déchéance pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Les effets de la déchéance, à savoir la perte des droits sur le signe pour l'avenir, commencent à la date de la demande ou antérieurement si la preuve est rapportée que la période de cinq ans était déjà arrivée à son terme. En d'autres termes, les atteintes postérieures portées sur la marque frappée de déchéance ne sauraient être accueillies et réparées. Quid, cependant, en cas d'atteinte survenue antérieurement à la date de prise d'effet de la déchéance, lorsque l'on sait que la marque en question n'a jamais fait l'objet d'une quelconque exploitation ? C'est sur cette question que la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est penchée dans un arrêt du 4 novembre 2020, ayant reçu les honneurs du Bulletin. Saisie d'un litige opposant le titulaire de la marque française « Saint Germain », désignant des boissons alcoolisées, aux sociétés distributrices d'une liqueur de sureau sous le vocable « St-Germain », la Cour de cassation s'est en effet prononcée, après avoir saisi la Cour de justice par voie de question préjudicielle. Cette dernière, dans un arrêt du 26 mars 2020 – commenté dans ces mêmes colonnes –, avait retenu qu'il revenait aux États membres de choisir les effets de la déchéance, notamment sur la question de la réparation des préjudices subis pendant le « délai de grâce », à savoir ce temps quinquennal pendant lequel le titulaire d'une marque est libre de commencer l'usage de sa marque, sans s'inquiéter des conséquences d'une absence d'usage. Suivant la solution préconisée par la Cour de justice, la chambre commerciale retient ici que le titulaire d'une marque dont la déchéance a été prononcée « est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » indépendamment de son usage. En effet, que la marque soit exploitée ou non, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire toutes les prérogatives de protection sur le signe. L'atteinte au titre ne peut être ignorée, quelle que soit son intensité. La chambre commerciale censure ainsi l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait refusé de constater l'atteinte du fait de l'absence d'exploitation pendant le délai de grâce.
La solution vient ainsi rappeler que le droit de marque est fondé, en premier lieu sur son enregistrement et non sur son usage. Qui plus est, faut-il rappeler que la portée du droit de marque s'apprécie au regard du signe tel qu'il est enregistré. Pour autant, les conséquences pratiques de la solution seront minimes en ce que, et la Cour de justice l'avait mentionné, contrairement à la constitution de l'atteinte, la réparation doit être évaluée au regard de l'usage qui a été fait de la marque. De fait, en l'absence d'usage de la marque durant le délai de grâce, le montant des dommages-intérêts alloués devrait être amoindri. Le mot de la fin reviendra à la Cour d’appel de Paris, devant laquelle la Cour de cassation renvoie l'affaire pour être jugée sur le fond du litige.
M.-S. B.




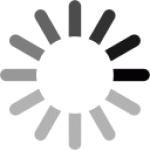
 S'abonner à Legipresse
S'abonner à Legipresse Feuilleter le dernier numéro
Feuilleter le dernier numéro