(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Vidéos
La dignité toute nue
La cour d'appel de renvoi rejette les demandes formées par une association contre l'organisateur de l'exposition L'Infamille, invoquant une atteinte à la dignité de la personne humaine garantie par l'article 16 du code civil. La cour énonce que si le principe du droit au respect de la dignité humaine revêt une valeur constitutionnelle, il ne constitue pas à lui seul, en l'absence d'allégations de toute atteinte à des droits concurrents à la liberté d'expression, un fondement autonome de restrictions de la liberté d'expression lui conférant la nature de droit concurrent et justifiant que soit effectué un contrôle de proportionnalité à ce titre.
L'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) est bien connue pour agir, depuis sa création, avec un insuccès fréquent(1), contre les œuvres qu'elle considère comme véhiculant des idées subversives, ce qui est conforme à ses statuts : lutter contre le racisme anti-Français, l'étalage public de la pornographie et « tout ce qui porte atteinte à la dignité de la femme et de l'enfant ». Elle poursuit ici le Fonds régional d'art contemporain (Frac) Lorraine pour avoir montré des œuvres d'Éric Pougeau dans le cadre d'une exposition intitulée L'Infamille. Les décisions précédemment rendues (nous en sommes à l'arrêt de renvoi) ont déjà été commentées dans ces pages(2).
Première difficulté procédurale, l'association est jugée irrecevable pour intenter l'action civile relative aux faits délictueux prévus à l'article 227-24 du code pénal. Pour rappel, ce texte dispose que « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». La Cour d'appel de Metz, dont nous avions commenté l'arrêt dans ces colonnes(3), avait rappelé que l'exercice de l'action civile relative aux infractions pénales est un droit exceptionnel strictement encadré par les limites fixées par le code de procédure pénale et en particulier son article 2-3. Or celui-ci limite l'intervention des groupes privés, dans le cadre des infractions mettant en péril les mineurs, dont celle prévue à l'article 227-24, aux affaires qui font l'objet d'une action publique, lorsqu'elle « a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ». En l'espèce, le parquet avait classé sans suite la plainte de l'association sur ce fondement. Elle ne pouvait donc agir au civil, confirme la Cour de cassation le 26 septembre 2018. C'est sur le terrain de l'atteinte à la dignité humaine que le débat judiciaire perdura, et la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt de renvoi du 16 juin 2021, vient de siffler l'arrêt de jeu.
I - Le recours à l'article 16 du code civil : qui ne tente rien n'a rien…
Dès sa saisine de première instance, l'association invoquait, par le biais de la responsabilité civile délictuelle et de l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, le droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre et, en particulier, la dignité humaine, en visant l'article 16 du code civil. Figurant dans un chapitre intitulé « Du respect du corps humain », cet article issu de la « loi bioéthique » du 29 juillet 1994 doit être rapproché de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH) qui dispose que la loi protège le droit à la vie.
La Cour d'appel de Metz rejetait le moyen avec un autre raisonnement : elle considérait, dans son arrêt du 19 janvier 2017, que l'article 16 n'a pas, en soi, une valeur normative, puisqu'il ne fait que rappeler des principes, renvoyant au législateur le soin de les appliquer. Or, si l'article dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie », il est parfois appliqué per se, de façon fort répressive, en lieu et place de la loi sur la presse(4), ce qui a amené la Cour de cassation à préciser comment il peut s'articuler avec la liberté d'expression(5). La liberté de la presse et le droit à l'information du public autorisent la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité ou illustrant avec pertinence un débat d'intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine, affirme la juridiction suprême qui contrôle la qualification des juges du fond des éléments journalistiques. Ainsi, pour la publication de la photographie du corps assassiné du préfet Claude Érignac, l'image publiée, représentant distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio, est jugée attentatoire à la dignité de la personne humaine, et illicite. Cette décision « se trouvant ainsi légalement justifiée au regard des exigences tant de l'article 10 de la Convention européenne que de l'article 16 du code civil », tranche la Cour de cassation en 2000(6).
La motivation de la Cour d'appel de Metz, dans ce contexte, était risquée, puisque la Cour suprême avait reconnu l'applicabilité de l'article 16 à des cas d'espèce dans des affaires importantes pour la République. L'AGRIF tenta sa chance et fit un pourvoi. La Cour de cassation tranche en 2018 dans son sens, affirmant que « le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis », et casse au visa de l'article 16 et de l'article 12 du code de procédure civile, lequel dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». La leçon était cinglante, seul l'article 4 du code civil interdisant le déni de justice n'étant pas invoqué.
Sans doute n'est-il pas inutile de rappeler la jurisprudence administrative en ce domaine, l'atteinte à la dignité humaine étant régulièrement invoquée contre la liberté d'expression, sans succès contre une affiche dénoncée comme sexiste de la mairie de Béziers tout récemment(7), mais avec succès contre Dieudonné, à raison des propos antisémites tenus dans son spectacle Le Mur, pour justifier l'interdiction de son spectacle(8). Le juge des référés du Conseil d'État a ainsi relevé que « la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté litigieux sont établies […] ; au regard du spectacle prévu, tel qu'il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine […] ».
À ce stade, les deux juridictions suprêmes s'accordent donc sur le fait que la dignité est un principe à valeur constitutionnelle. Mais le vent de la liberté continue de souffler, de Metz à Paris, sur les juges, dans l'affaire qui nous occupe ici. Il passe par le quai de l'Horloge, et se propage dans le palais.
II - L'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme : la satire plus forte que la moraline
A - Les prolégomènes
L'affaire opposant l'AGRIF au FRAC Lorraine était donc renvoyée à la Cour d'appel de Paris. Entre-temps, en 2019, l'assemblée plénière de la Cour de cassation(9), dans une autre affaire, décidait que la dignité de la personne humaine ne figure pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérés par l'article 10, § 2, de la Conv. EDH ; si elle est de l'essence de la Convention, elle ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d'expression. Ce faisant, la Cour de cassation ne remet pas en cause sa jurisprudence sur le droit à l'image et la dignité des victimes. On se souvient qu'elle avait validé la condamnation de la publication de photographies de victimes d'assassinat étant précisé que l'action de la famille des victimes était également fondée sur l'article 9 du code civil et la protection de l'image du défunt et portée par des proches en deuil, affectés par la publication. C'est l'atteinte à la mémoire du mort qui est ainsi réprimée via le droit de la personnalité. Ce que le doyen Gridel écrivait en commentant la décision Érignac de la Cour suprême, à savoir que le principe traditionnel du respect dû à la dignité de la personne humaine, fût-ce par-delà sa mort, est hiérarchiquement supérieur à l'intimité de la vie privée, n'est pas remis en cause. Et quand l'image publiée n'apporte rien à la libre et nécessaire information, le respect dû à la dignité de l'être humain, qui ne cesse pas avec son décès, fait obstacle à la publication par voie de presse de certaines images tirées de l'actualité, si elles sont dégradantes pour la personne.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a d'ailleurs, à l'unanimité, considéré conforme à l'article 10 de la Convention l'interdiction de publier la photographie d'une personne (le jeune Ilan Halimi) aux mains de ses ravisseurs, et décédée ensuite. Par ordonnance de référé du 20 mai 2009, le vice-président du Tribunal de grande instance de Paris avait condamné le magazine Choc à retirer le numéro du magazine publiant cinq fois la photographie, de tous les points de vente, sous astreinte. La cour d'appel de Paris ordonnait, de façon plus proportionnée, que soient occultées, par tout moyen utile et inaltérable, les cinq reproductions de la photographie dans tous les magazines mis en vente ou en distribution. Et la Cour de cassation approuvait. La CEDH, saisie par le magazine, considère sur le fondement de l'article 10 que cette ingérence était prévue par la loi en ce qu'elle était fondée sur l'article 9 du code civil, dont l'application était prévisible en l'espèce. Et elle ajoutait qu'il « en va de même s'agissant de l'application de l'article 16 du code civil dans les circonstances de l'espèce », la précision finale étant d'importance. L'explication figure dans l'ordonnance et l'arrêt de la cour d'appel, que la CEDH approuve : la photographie, suggérant la soumission et la torture, était indécente et portait atteinte à la dignité humaine. La Cour de Strasbourg rattache l'appréciation de la dignité au droit des victimes à l'article 8 : « Certains événements de la vie privée et familiale font l'objet d'une protection particulièrement attentive au regard de l'article 8 de la Convention et doivent donc conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution lors de leur traitement ». La Cour européenne procédait donc à une balance des intérêts et droits en cause.
Ce détour par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg était nécessaire pour comprendre la décision de l'assemblée plénière de 2019, rendu un an après l'arrêt de la Cour de cassation de 2018 dans l'affaire du FRAC Lorraine. Le contrôle de proportionnalité exigé par la CEDH depuis les arrêts de grande chambre Axel Springer AG et Von Hannover c/ Allemagne (no 2) du 7 février 2012 est bien connu lorsque la liberté d'expression est opposée à la vie privée et au droit à l'image, le principal critère étant la contribution de la publication à un débat d'intérêt général, mais également la notoriété de la personne visée et l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et les circonstances de la prise des photos. Gardons ces critères à l'esprit, s'agissant de la prétention de l'AGRIF de confronter une œuvre exposée dans un lieu d'art au critère subjectif de la dignité sans offrir d'autre argument au juge que sa propre analyse subjective. Quand bien même le débat serait admis, il y a fort peu de chance que la CEDH admette qu'une valeur présentée comme indiscutable mette en échec la liberté d'expression sans contrôle de proportionnalité.
Quelles étaient les circonstances de l'espèce tranchée par l'assemblée plénière en 2019 ? La Cour de cassation a pris soin de publier une note explicative et de rappeler les faits. Dans une émission télévisée de grande écoute, étaient montrées plusieurs affiches parodiques attribuées à des candidats à l'élection présidentielle, qui avaient été publiées dans l'édition du 4 janvier 2012 du Journal Charlie Hebdo. Celle incriminée représentait une candidate sous la forme d'un étron fumant sur fond bleu blanc rouge avec le slogan suivant : « Le Pen, la candidate qui VOUS ressemble ». La candidate poursuit pour injure devant les juridictions du fond, sans succès, et la Cour de cassation casse au motif de l'atteinte à la dignité : « Le dessin et la phrase poursuivis, qui portaient atteinte à la dignité de la partie civile en l'associant à un excrément, fût-ce en la visant en sa qualité de personnalité politique lors d'une séquence satirique de l'émission précitée, dépassaient les limites admissibles de la liberté d'expression ».
La Cour d'appel de Paris résiste. Le dessin est matériellement injurieux et grossier, certes. Et s'il porte atteinte à la dignité de la personne, il doit être condamné. Mais il n'y a pas atteinte à la dignité de Madame Le Pen en raison de quatre critères : la forme d'humour satirique revendiquée par cette publication, le défaut de l'utilisation de l'image de la partie civile, la circonstance qu'au regard du contexte de sa diffusion et de sa teneur, l'affiche litigieuse, qui renvoie tant à la partie civile qu'à son électorat auquel elle « ressemble », comporte implicitement mais nécessairement une appréciation de son positionnement politique dans le cadre de l'élection présidentielle. Sur le plan de l'intention, la cour retient que la candidate aux présidentielles était visée en sa seule qualité de personnalité politique, sans attaque personnelle, et que l'animateur de l'émission a fait preuve de distanciation en avertissant le public de l'origine et du caractère polémique des affiches. La cour d'appel applique donc la jurisprudence européenne et fait une balance des intérêts dans un registre rationnel, à l'aide de critères objectifs. L'assemblée plénière se range à cette approche en 2019, en proclamant que le principe du respect de la dignité de la personne humaine ne constitue pas un fondement autonome des restrictions à la liberté d'expression. Elle refuse donc à la dignité le statut de valeur indiscutable. Le contrôle de proportionnalité reste une nécessité en cas d'éventuelle atteinte à la dignité, explique la note précitée. Cette décision « capitale » rejoint la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui considère que le respect de la dignité humaine doit « être concilié avec les exigences relatives aux droits protégés par ledit traité et être conforme au principe de proportionnalité ».
B - L'acmé
C'est à la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt commenté, qu'il revient d'expliquer cette décision. La protection de la réputation ou des droits d'autrui n'est pas mentionnée dans les restrictions prévues à la liberté d'expression dans le deuxième paragraphe de l'article 10. La protection de la réputation est quant à elle prévue à l'article 8 de la Conv. EDH, dans le cadre de la protection de la vie privée. Elle rappelle que la réputation d'une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d'un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et, dès lors, relève de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention. C'est complètement absurde, certes, mais c'est ainsi que la Cour européenne assure le contrôle de la balance des intérêts. Et répare les oublis des rédacteurs de la Convention.
Force est de constater avec la cour d'appel de Paris que jamais la Cour de Strasbourg n'a consacré la dignité humaine comme fondement autonome de restriction de la liberté d'expression en l'absence de conflit avec un droit concurrent tel que le droit au respect de la vie privée ou le droit à l'image. Mais, n'écoutant que son courage, l'AGRIF tentait le tout pour le tout : faire juger que la dignité humaine ressortit à l'article 3 de la Convention, à l'article 8, et aux restrictions prévues par l'article 10, § 2, à la liberté d'expression. Selon l'association, elle constituerait une composante nécessaire de la protection de la morale, de la défense de l'ordre et même des droits d'autrui. Il s'agit, selon elle, de faire respecter « le principe supérieur de protection et de respect de l'enfant auxquels ce dernier et ses parents ont droit ». Décodons. L'œuvre incriminée, constituée de lettres fictives par des parents fictifs indignes promettant à leur progéniture fictionnelle, avec beaucoup de tendresse, les pires sévices fictifs, relèverait de l'article 16 du code civil, alors que celui-ci consacre, dans le cadre de la protection du corps humain, le droit à la dignité et à la vie des personnes existantes, incarnées, pas de personnes fantasmées. Elle invoque ensuite que la dignité relèverait de l'article 3 de la Conv. EDH qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Là encore, l'article 3 concerne les personnes réelles. Peu chaut à l'AGRIF. Et enfin, l'article 8 protège la vie privée. S'agissant de personnages imaginaires, qui n'ont par définition aucun droit, puisqu'ils n'existent pas, il n'a pas vocation à l'appliquer.
Pourquoi, face à cette distorsion des dispositions nationales et conventionnelles, la cour d'appel ne se contente-t-elle pas de rappeler cette évidence de l'absence du corpus victimae. Et pourquoi diable rouvre-t-elle la porte du débat en répondant que l'AGRIF affirme plutôt qu'elle ne démontre que la dignité fait partie de l'ordre public et de la morale ? Quel est l'argument de l'association ? Selon elle, « c'est au nom de “l'ordre, de la prévention du crime, de la protection de la morale, et de la protection des droits d'autrui” [art. 10, § 2, Conv. EDH) que l'article 16 du code civil a entendu édicter les limites à la liberté d'expression ». C'est faux. L'article 16 n'est pas une loi de restriction de la liberté d'expression mais de protection du corps et de la représentation, par l'image, de corps réels. Il eût été simple de l'expliquer à l'association. La dignité ne peut donc servir de restriction à la liberté d'expression que dans le contexte de la confrontation de celle-ci avec d'autres droits en concurrence, tels que le droit au respect de la vie privée, ou le droit à l'image. Le droit au respect de la dignité humaine ne constitue pas en soi une restriction autonome à la liberté d'expression justifiant que soit effectué un contrôle de proportionnalité à ce titre.
III - La vraisemblance au cœur de la jurisprudence sur la dignité humaine
Aucun article ne consacre le droit à la dignité humaine dans la Convention européenne. La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît toutefois que « la dignité, comme la liberté, est de l'essence même de la Convention » et fait une application abondante de la nécessité pour les États membres de la respecter.
En droit interne, les références à la dignité humaine sont nombreuses, notamment dans les textes de loi qui servent à étayer la censure. Les représentations gravement indignes sont réprimées théoriquement, sous condition de gravité, par l'article 227-24 du code pénal. Le code du cinéma et de l'image animée, modifié en 2009, a intégré le respect de la dignité humaine dans les raisons, aux côtés de la protection de l'enfance, pour lesquelles un visa (permis administratif nécessaire à l'exploitation d'un film en salles) peut être refusé ou soumis à conditions. Ce qui permet une censure en amont beaucoup plus efficace. Mais ces dispositions ne définissent pas la dignité humaine. Celle-ci devient appréhendable, évaluable, quand elle touche au corps humain. C'est bien pourquoi la Convention européenne dispose dans son article 3 que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
On se souvient de l'exposition Our Body à corps ouvert, qui se tenait à Paris dans un espace privé, aux beaux jours du printemps 2009, et fut interdite par la juridiction civile en référé le 21 avril 2009, décision confirmée en appel le 30 avril 2009. Dans cette affaire, une société avait exposé des cadavres plastinés, procédé de conservation qui permet de montrer les « mystères » de l'intérieur du corps humain, dans des postures inspirées (Le Penseur de Rodin au cerveau découvert, un marathonien viscères et muscles à l'air…). Il se trouve que les corps, achetés en Chine, étaient ceux de détenus décédés. Deux associations, Solidarité Chine et Ensemble contre la peine de mort, œuvrant pour le respect de droits de l'homme, dénoncèrent cette utilisation de corps de personnes réelles, condamnés à mort chinois. La Cour de cassation confirma le 16 septembre 2010 ces décisions, qui forment donc le corpus très vivant (trois motivations différentes, voir mon analyse) d'une première interprétation du nouvel article 16-1-1 du code civil. L'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît l'exigence de traiter les restes humains avec respect, dignité et décence, nous dit la Cour.
Comme dans l'affaire Halimi et comme dans toutes les affaires dans lesquelles l'atteinte à la dignité humaine est tangible, la limite à la liberté d'expression est admissible dès lors qu'elle est évaluable. Les détenus chinois n'avaient pas donné leur accord pour que leur corps soit modifié et exposé. On conçoit la différence entre cette violation caractérisée du respect dû à ce qui nous constitue, ou nous a constitués, et un dessin fantaisiste qui représente une personne sans aucune prétention à la vraisemblance physique. De fait, les femmes et les hommes politiques, qui affrontent le public avec leurs idées, sont légitimement exposés, selon les juges, à la caricature, représentation qui n'est pas toujours conforme avec l'image d'eux-mêmes qu'ils voudraient voir circuler. Le corps de Marine Le Pen n'est pas un étron. Personne ne peut croire que le dessin en question se confond avec elle, ou la représente de façon vraisemblable : il vise ses idées dans le cadre d'un débat politique et c'est ce qui emporte la conviction des juges.
La Cour de Strasbourg a fait fonctionner le critère de l'exception artistique dans son arrêt Vereinigung Bildender Künstler c/ Autriche à propos d'une œuvre d'Otto Mühl présentant sur des corps peints des photographies découpées de visages de personnes célèbres, dans une mise en scène tout à fait indigne. Un homme politique s'était plaint avec succès devant les juridictions autrichiennes d'avoir été représenté agrippant le pénis éjaculant de M. Haider pendant qu'il était touché par deux autres membres de son parti (FPÖ) et éjaculant sur mère Teresa. La peinture avait été considérée comme dégradante et insultante pour lui par la Cour de cassation viennoise.
Mais la CEDH rappelle que « la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique », l'une des « conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun », qu'elle « vaut non seulement pour les “informations” ou “idées” accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de “société démocratique” ». Comme elle le justifie dans chaque arrêt sur la question et quel que soit le sens de sa décision, elle affirme que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique ». Elle affirme l'obligation, pour les États, de ne pas empiéter indûment sur la liberté d'expression non seulement des artistes mais de ceux qui diffusent les œuvres, tout en précisant qu'ils n'échappent pas aux possibilités de limitation prévus par le paragraphe 2 de l'article 10 de la Conv. EDH : « Quiconque se prévaut de sa liberté d'expression assume en effet, selon les propres termes de ce paragraphe, des “devoirs et responsabilités” ; leur étendue dépend de sa situation et du procédé utilisé ». Il eût été utile que la cour d'appel rappelle ces principes fondamentaux, face à la demande de l'AGRIF.
La description de l'œuvre de Mühl est déterminante. La Cour note qu'elle « représentait M. Meischberger de manière quelque peu outrageante, c'est-à-dire nu et en train de se livrer à des activités sexuelles. M. Meischberger, ancien secrétaire général du Parti libéral autrichien et, à l'époque des faits, député, était montré en interaction avec trois autres membres de premier plan de son parti, dont M. Jörg Haider, qui était alors le chef du FPÖ et a depuis fondé un autre parti ». Mais elle souligne que « le tableau n'utilisait des photos que pour les têtes de ces personnes, et que leurs yeux étaient cachés par des bandes noires et leurs corps peints de manière irréaliste et exagérée ». Les moyens artistiques utilisés ont donc pour but de rendre la représentation invraisemblable. La Cour note d'ailleurs que les juridictions autrichiennes de tous les niveaux « ont communément estimé que le tableau ne visait à l'évidence nullement à refléter ou même à évoquer la réalité ». L'intention de l'auteur est donc caractérisée. « Un tel mode de représentation s'analyse en une caricature des personnes concernées au moyen d'éléments satiriques […]. La satire est une forme d'expression artistique et de commentaire social qui, de par l'exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter ». La Cour conclut que le plaignant, bien moins connu que d'autres personnes représentées par Mühl, devait supporter la caricature sans broncher.
Protestation du juge Loucaides, qui publie sous l'arrêt de la Cour une opinion dissidente : il refuse à l'œuvre son statut d'œuvre, et méconnaît le fait que le tableau n'était pas poursuivi pour atteinte à la morale, mais pour atteinte à la réputation d'un seul plaignant : « On ne peut juger de la nature, de la signification et de l'effet de toute image figurant dans un tableau en se fondant sur ce que le peintre a voulu transmettre. Ce qui compte est l'effet sur l'observateur de l'image qu'il voit. De plus, ce n'est pas parce qu'une image est produite par un artiste que le résultat final est obligatoirement “artistique”. De même, une image n'acquiert pas un caractère “satirique” si l'observateur ne comprend pas ou ne perçoit pas le message transmis sous la forme d'une attaque ou d'une critique pleine de sens s'appliquant à un problème particulier ou à la conduite d'une personne. Selon moi, le tableau en question ne saurait, quelque effort d'imagination que l'on déploie, être qualifié de satirique ou artistique. Il montre un certain nombre de personnalités sans lien les unes avec les autres (certaines appartenant au monde politique, d'autres au monde religieux) représentées de manière vulgaire et grotesque dans des images dépourvues de sens et dégoûtantes montrant des pénis en érection et en éjaculation et des corps nus adoptant des positions sexuelles répugnantes, certaines associant même la violence, avec des organes génitaux ou des seins en couleur et de taille disproportionnée ». Ainsi, selon lui, les éléments réels de la représentation (visages) qu'il détaille soigneusement mais qu'il confond avec les dessins ajoutés (sexes) auraient dû emporter une interprétation littérale de l'œuvre. La colère de ce juge viendrait donc de ce qu'il n'est pas capable, face à une représentation, de distinguer entre réel et fiction.
Le droit de la caricature et de la satire est une particularité française. Dans l'affaire de l'exposition Infamille, nul doute que l'œuvre d'Éric Pougeau participe directement à un débat d'intérêt général puisqu'il critique très vivement, dans des textes complètement distanciés, de fiction, ne représentant personne en particulier, les horreurs qui se déroulent dans le secret des familles. Par du texte seul, des fausses lettres laissées par des parents fictifs à des enfants fictifs. Tellement violentes qu'elles en sont drôles, même si elles ne font pas rire tout le monde, le succès de l'œuvre n'étant pas une obligation pour sa protection. Il est impossible de ne pas voir, sauf par calcul politique, la distance mise par l'artiste entre le sujet et la réalité. Il est impossible de croire que ces lettres étaient des menaces sérieuses. Et à qui ?
La Cour d'appel de Paris, dans l'arrêt de renvoi, cite les articles 1er et 2 de la loi du 7 juillet 2016, qui consacrent la liberté de création. Pourquoi ne pas poursuivre, et faire la différence sémantique et conceptuelle entre l'image d'un corps réel, un article de presse et une représentation fictionnelle, en l'espèce formée de quelques mots sur un bout de papier ? C'est une occasion ratée de faire de la pédagogie utile. D'ailleurs, l'AGRIF fait un nouveau pourvoi.
Conclusion
Les textes d'Éric Pougeau ne sont pas des atteintes à la loi, et ne constituent ni une menace pour les enfants ni une atteinte à la dignité humaine. Ce sont les horreurs réelles qui heurtent la dignité humaine, pas leur représentation artistique. George Sand et Stendhal défendaient, il y a cent-quatre-vingts ans – le combat contre la tentation de la censure n'est donc jamais définitivement gagné, on le voit –, la liberté pour l'auteur de choisir son sujet et les moyens artistiques pour le traiter. « L'écrivain n'est qu'un miroir qui reflète, une machine qui décalque, et qui n'a rien à se faire pardonner si ses empreintes sont exactes, si son reflet est fidèle », affirmait George Sand. Dans Le Rouge et le Noir, on se souvient que Stendhal fait dire à son narrateur que la page qu'il écrit nuira à son auteur, « les âmes glacées l'accuseront d'indécence », et il poursuit dans une apostrophe au lecteur : « Hé, Monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d'être immoral ! Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir ! Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plus encore l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former ».




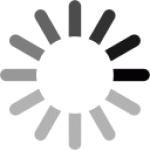
 S'abonner à Legipresse
S'abonner à Legipresse Feuilleter le dernier numéro
Feuilleter le dernier numéro