(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Vidéos
Droit des marques (Octobre 2018 – Octobre 2019)
Si l'année 2019 sera nécessairement marquée par l'adoption de l'ordonnance de transposition de la directive (UE) 2015/2436, sur laquelle ne manqueront pas de revenir universitaires et praticiens, impossible toutefois de faire abstraction d'une jurisprudence, une fois de plus, pléthorique et riche de nombreux enseignements dans le domaine du droit des marques. La présente synthèse se propose de revenir, dans un premier temps, sur l'actualité européenne du droit des marques, puis, dans un second temps, sur l'actualité française du droit des marques. Il y sera notamment question des signes antériorisés par une dénomination variétale, de l'appréciation de la distinctivité par l'usage, de l'usage d'une marque comme label de test ou bien encore de l'appréciation de l'usage sérieux.
Marie-Sophie Bergazov
Diplômée du CEIPI
Clémence de Marassé Enouf
Diplômée du CEIPI
Chloé Piedoie
Diplômée du CEIPI
Maëlle Sengel
Diplômée du CEIPI
Romain Soustelle
Diplômé du CEIPI
I – Actualité européenne du droit des marques
A – Existence du droit de marque
Dénomination d'une variété végétale. Le nouvel article 7, § 1 m), du règlement (UE) 2017/1001 du 17 juin 2017 précise que doivent être refusés à l'enregistrement ou annulés les signes consistant en une dénomination de variété végétale antérieurement enregistrée ou reproduisant cette dénomination dans ses éléments essentiels et portant sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée. Cet article a fait l'objet de sa première application par le Tribunal de l'Union européenne dans un arrêt du 18 juin 2019(1). Une société allemande W. Kordes Söhne avait demandé l'enregistrement du signe Kordes'Rose Monique en tant que marque de l'Union européenne afin de désigner les produits suivants : « roses, rosiers et produits favorisant la multiplication des roses ». Suite à des observations de tiers ayant signalé l'existence d'une obtention végétale enregistrée en 2001 sous la dénomination Monique au registre néerlandais de la protection des obtentions végétales et bénéficiant d'une protection jusqu'en 2005, la demande d'enregistrement fut rejetée par l'EUIPO. D'une part, le terme Monique est identique à une dénomination variétale antérieure et constitue l'élément essentiel de la marque litigieuse. D'autre part, la dénomination en cause concerne une variété de rose, correspondant aux produits pour lesquels la protection était recherchée.
L'analyse ne convainc toutefois pas le Tribunal de l'Union européenne qui note que le but de cette nouvelle disposition est d'empêcher la création d'un monopole sur une dénomination variétale, celle-ci devant rester à la libre utilisation de tous(2). En effet, la dénomination donnée à une variété végétale devient sa désignation générique, impliquant qu'elle soit insusceptible de faire l'objet d'une réservation au titre du droit des marques, et ce, quand bien même le titre aurait expiré(3).
Le tribunal se prononce ensuite sur la notion d'« élément essentiel » visée par le texte. Constatant que cette notion n'est pas définie, il procède, céans, à son interprétation. Les juges notent que la dénomination variétale ne sera l'élément essentiel de la marque demandée à l'enregistrement que si la fonction de garantie d'origine de la marque repose sur cette dénomination et non sur les autres éléments du signe(4). Dans un tel cas, la dénomination variétale ne pourrait plus être utilisée par des tiers et, partant, entraverait le jeu de la libre concurrence. Afin de déterminer si une marque repose sur une dénomination variétale ou sur d'autres éléments la composant, il est nécessaire d'avoir recours à une multitude de critères, tels que : le caractère distinctif des autres éléments, le message véhiculé par la marque demandée dans son ensemble, la domination visuelle des différents éléments par leur taille et leur position ou, encore, le nombre d'éléments la composant.
Le tribunal estime dans la présente affaire que le terme Kordes permet d'identifier l'origine commerciale des produits couverts par la marque et constitue donc son élément essentiel ou, plutôt, dominant(5) : l'usage du génitif exprime l'idée selon laquelle les roses Monique proviennent de l'entreprise Kordes ; l'élément verbal Kordes est en position d'attaque ; le terme Monique est utilisé dans un sens strictement générique. En somme, la présence du terme Monique dans la marque demandée ne s'oppose pas à son enregistrement, le terme restant disponible aux autres acteurs économiques pour désigner la variété en question.
R. S.
Validité d'une marque de couleur. Dans un arrêt du 27 mars 2019(6), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par voie de question préjudicielle, est revenue sur la question de l'appréciation de la distinctivité d'une marque de couleur. L'occasion lui était également donnée de se prononcer, pour la première fois, sur les conséquences d'une contradiction entre le signe et la qualification qui lui est donnée par le déposant.
En 2012, la société Oy Hartwall déposa une demande de marque de couleur dont « les couleurs du signe sont le bleu (PMS 2748, PMS CYAN) et le gris (PMS 877) ». Le déposant précisa toutefois qu'il sollicitait l'enregistrement de la marque en tant que « marque de couleur » et non en tant que « marque figurative ». Par une décision de 2013, l'Office rejeta la demande d'enregistrement au motif que les preuves de l'acquisition de la distinctivité par l'usage concernaient le dessin composé de contours définis et non les couleurs per se. L'office finlandais impose en effet pour les marques de couleur que soit rapportée, au moment du dépôt, la preuve de l'acquisition de la distinctivité par l'usage. La juridiction de renvoi, la Cour administrative suprême finlandaise (Korkein hallinto-oikeus), saisie après que le déposant ait été débouté de son recours, décida de surseoir à statuer afin d'interroger la Cour de justice sur la question de l'incidence de la qualification de la marque sur l'appréciation de la distinctivité, ainsi que sur les conséquences de la contradiction entre la qualification du signe et la représentation graphique du signe.
S'agissant de l'incidence de la nature du signe sur l'appréciation de la distinctivité, la Cour de justice rappelle que rien ne justifie que les offices appliquent aux marques qualifiées de non traditionnelles des critères plus stricts ou supplémentaires afin d'apprécier leur distinctivité(7). La nature de la marque ne doit donc pas être utilisée par les offices comme un préjugé, leur permettant de considérer certains signes comme n'étant jamais distinctifs ab initio. Les autorités compétentes sont ainsi tenues, quelle que soit l'hypothèse, d'apprécier la distinctivité d'une marque in concreto, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce(8).
Concernant ensuite la contradiction entre le signe et sa qualification, la Cour de justice considère qu'il en résulte une incertitude quant à l'objet et l'étendue de la protection, en ce qu'il n'est pas possible de déterminer si la protection est recherchée pour la couleur ou le dessin composé de contours déterminés. Par conséquent, une telle contradiction doit être considérée comme allant à l'encontre des exigences de clarté et de précision de représentation du signe, justifiant le rejet d'une demande d'enregistrement ou l'annulation de la marque(9).
M. S.
Distinctivité autonome. Afin de faire l'objet d'un enregistrement à titre de marque, le signe déposé doit être distinctif au regard des produits et services désignés. Cette exigence, véritable clé de voûte du droit des marques, doit être appréciée in concreto par les autorités compétentes, et ce, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents, tel que l'usage probable qui peut être fait du signe. C'est ce que rappelle la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt, rendu sur question préjudicielle, du 12 septembre 2019. Dans cette affaire, une société, souhaitant enregistrer auprès de l'office national allemand la marque verbale #darferdas ? (Peut-il faire cela ?) en vue de désigner des vêtements, a vu sa demande rejetée pour défaut de distinctivité autonome, le signe constituant un élément verbal commun ne pouvant pas être distingué des termes communs apposés traditionnellement sur des tee-shirts. Devant la Cour fédérale de justice allemande, le déposant fit valoir que le signe n'était pas nécessairement dépourvu de distinctivité en fonction de l'usage qui en était fait. La juridiction de renvoi nota, en effet, qu'en fonction de l'usage qui pouvait être fait du signe, il n'était pas exclu que le signe litigieux puisse remplir la fonction de garantie d'identité d'origine. Elle décida alors de surseoir à statuer et d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne de la manière suivante : « Un signe a-t-il un caractère distinctif dès lors qu'il existe des possibilités significatives en pratique et plausibles de l'utiliser pour indiquer l'origine commerciale des produits et services concernés, alors même qu'il ne s'agit pas de l'utilisation la plus probable du signe ? ».
La Cour de justice répond par l'affirmative en précisant que « le caractère distinctif d'un signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé doit être examiné en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris l'ensemble des modes d'usage probables de la marque demandée ». Les juges invitent à apprécier la validité du signe au terme d'une analyse in concreto, formule qui aurait de quoi surprendre lorsque l'on sait que la distinctivité s'apprécie in abstracto, au regard des éléments visés dans la demande d'enregistrement. La solution n'est toutefois pas nouvelle. En outre, la Cour de justice se garde d'avoir une approche factuelle – et partant concrète – en proposant de tenir compte, in abstracto, des pratiques significatives dans les secteurs économiques concernés par les produits et services désignés, celles-ci pouvant s'avérer déterminantes dans l'appréciation de la distinctivité. La juridiction de renvoi ayant identifié deux modes d'apposition significatifs dans la pratique du secteur de l'habillement, il lui appartiendra de déterminer si le consommateur moyen percevra le signe, apposé sur le devant d'un tee-shirt ou sur l'étiquette apposée à l'intérieur de celui-ci, comme une marque.
C.dM-E.
Descriptivité d'un signe géographique. Dans un arrêt du 6 décembre 2018, la Cour de justice, interrogée par la Cour suprême du Portugal, se prononce sur l'interprétation à donner à l'article 3, § 1 c), de la directive 2008/95/CE, afin de déterminer la validité d'une marque composée du terme adega, signifiant « cave » en français, et d'un nom géographique protégé comme appellation d'origine, enregistrée pour désigner des produits vinicoles.
Dans cette affaire, la partie requérante, J. Portugal Ramos Vinhos, souhaitait obtenir, sur le fondement de l'article 223 du code de la propriété industrielle portugais, l'annulation de la marque adegaborba.pt, enregistrée pour désigner des produits vinicoles et détenue par l'Adega Coopérativa de Borba. Cet article reprend à l'identique l'article 3, § 1 c) de la directive 2008/95/CE. Il y ajoute toutefois comme exclusion les « moyens de production du produit », là où la directive fait simplement état de signes ou d'indications « pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ». La juridiction de renvoi, s'interrogeant sur la portée de cette différence de rédaction, se demande si une marque intégrant le terme adega, renvoyant à la fois à un local souterrain dans lequel est conservé le vin et à des installations ou locaux dans lesquels sont élaborés des produits vinicoles devait être considérée comme descriptive.
La Cour de justice rappelant la non-exhaustivité de la liste énumérée par l'article 3, § 1 c), la différence de rédaction des deux articles se retrouve sans portée. En effet, la formule « d'autres caractéristiques » permet de refuser l'enregistrement de tout signe qui désignerait les propriétés d'un produit, facilement reconnaissables par les milieux intéressés. Suivant ce principe, la Cour affirme que le terme adega est descriptif des produits vinicoles comme désignant une caractéristique de ces derniers. L'utilisation de ce terme avec l'élément verbal Borda, lui-même descriptif en ce qu'il renvoie à une région du Portugal, empêche le signe contesté de satisfaire à l'exigence de distinctivité.
C. P.
Acquisition de la distinctivité par l'usage. Par un important arrêt du 19 juin 2019, le Tribunal de l'Union européenne confirme l'annulation de la marque figurative à « trois bandes » – marque phare de la société Adidas –, représentée par trois bandes noires sur un fond blanc, enregistrée en 2014 pour désigner en classe 25 des vêtements. Le titulaire échoue à rapporter la preuve que le signe litigieux avait acquis un caractère distinctif par l'usage. L'arrêt, particulièrement long, se caractérise par sa densité et la richesse de ses enseignements.
La société Adidas soutenait que la chambre de recours avait « mal interprété » la marque litigieuse, en ne constatant pas qu'il s'agissait d'une marque de motif, définie par le règlement d'exécution comme un signe consistant « exclusivement en un ensemble d'éléments qui se répètent de façon régulière ». Une telle qualification aurait justifié, notamment, de prendre en considération des preuves d'usage reproduisant la marque litigieuse dans des dimensions différentes en fonction des produits sur lesquels elle était apposée. Le reproche fait à la chambre de recours n'emporte pas la conviction des juges européens qui notent, d'une part, que la distinction entre les marques figuratives et les marques de motif n'existait pas au moment du dépôt du signe litigieux et, d'autre part, qu'il ne ressort aucunement de sa représentation qu'il est composé d'éléments qui se répètent régulièrement ayant vocation à s'étendre sur toute la surface du produit désigné. Dès lors, la chambre de recours n'a commis aucune erreur en considérant qu'il s'agissait d'une marque figurative ordinaire.
La requérante invoqua ensuite la « loi des variantes autorisées », théorie qui autoriserait à tenir compte de l'usage d'une marque sous une forme modifiée par rapport au signe tel qu'enregistré, sous réserve toutefois, qu'en dépit des modifications, les signes soient considérés comme globalement équivalents. En d'autres termes, les règles connues en matière d'usage sérieux permettant d'éviter la déchéance des droits du titulaire, envisagées à l'article 18, § 1, du règlement sur la marque de l'Union européenne, devraient trouver à s'appliquer dans le cadre de l'article 7, § 3, relatif à l'acquisition de la distinctivité par l'usage. L'enjeu était de taille pour Adidas, qui se prévalait de nombreuses preuves d'usage ne faisant pas apparaître la marque à trois bandes telle qu'elle avait été enregistrée.
Jusqu'à présent le tribunal s'était opposé à l'application de cette « loi des variantes autorisées ». Il opère ici un revirement étonnant. Pour ce faire, il rappelle que les exigences prévalant en ce qui concerne la vérification de l'usage sérieux d'une marque sont analogues à celles concernant l'acquisition du caractère distinctif d'un signe par l'usage en vue de son enregistrement. Dès lors, les formes d'usage d'une marque, visées par l'article 18, § 1, y compris celles qui ne diffèrent que par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque, doivent être prises en compte aux fins de déterminer si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait au sens de l'article 7, § 3, de ce même règlement. Si la solution peut surprendre, elle s'inscrit toutefois dans une logique de création d'un véritable « droit commun » de l'usage, le tribunal s'étant également prononcé en ce sens à propos de la preuve de la renommée d'une marque.
Si l'argument emporte l'assentiment du tribunal, il ne permet toutefois pas d'annuler la décision de la chambre de recours, celle-ci ayant fait application de cette « loi des variantes autorisées ». Elle a en effet constaté, eu égard à la grande simplicité de la marque litigieuse, que les légères variations dont elle avait fait l'objet dans le cadre de son exploitation – l'inversion du schéma de couleurs – empêchaient de considérer le signe utilisé comme globalement équivalent au signe enregistré.
Le tribunal conclut en relevant le caractère non pertinent des nombreuses preuves produites (12 000 pages) par la société Adidas. Les données relatives au chiffre d'affaires et aux dépenses de marketing et de publicité concernaient l'ensemble de l'activité du titulaire, rendant impossible l'établissement d'un lien avec la marque en cause. Il en allait de même des études de marché qui ne portaient pas sur des signes globalement équivalents à la marque enregistrée ou qui étaient biaisées au regard des questions posées. Enfin, les rares preuves pertinentes ne permettaient pas de démontrer que le signe avait acquis une distinctivité dans l'ensemble de l'Union européenne. Pour l'ensemble de ces raisons, le tribunal note que la Chambre de recours n'a commis aucune erreur en retenant que le titulaire avait échoué à démontrer l'acquisition de la distinctivité par l'usage de la marque litigieuse.
M.-S. B.
Droit transitoire et notion de forme qui donne sa valeur substantielle au produit. Fondement essentiel de préservation de l'intelligibilité des lois, le principe de sécurité juridique garantit la cohérence et la prévisibilité des règles de droit face, notamment, aux évolutions législatives. À l'occasion d'un arrêt du 14 mars 2019, la Cour de justice a, en application de ce principe directeur, éclairci les questions de droit transitoire se posant après l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne.
Saisie à propos d'un conflit portant sur la validité d'une marque au sens de l'article 7, § 1 e), la Cour d’appel de Stockholm interroge la Cour de justice à propos de l'applicabilité à la marque litigieuse du nouveau règlement sur la marque de l'Union, et ce, alors qu'elle avait été enregistrée avant son entrée en vigueur.
Conformément au principe de sécurité juridique, la Cour de justice considère que le législateur européen n'a pas eu l'intention de conférer une quelconque portée rétroactive au nouveau texte s'agissant des motifs de refus, empêchant son application aux marques enregistrées antérieurement à son entrée en vigueur. Cette solution, qui doit emporter l'assentiment, s'explique, non seulement en raison du silence du règlement quant à son éventuelle portée rétroactive, mais aussi de la finalité et de l'économie du texte.
En sus de cette question de droit transitoire, la juridiction de renvoi interroge la Cour afin de savoir si l'article 7, § 1 e) iii), doit être interprété en ce sens qu'un signe consistant en des motifs bidimensionnels décoratifs apposés sur des produits tels que du tissu ou du papier est « constitué exclusivement par la forme ». Citant son arrêt Louboutin, la Cour de justice rappelle que la notion de « forme » en droit des marques se définit comme un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit dans l'espace. Elle considère, suivant cette définition, qu'un signe, tel que celui faisant l'objet du litige, ne saurait être constitué exclusivement par la forme au sens de l'article 7, § 1 e) iii). Il ressort de l'analyse des caractéristiques du signe, dans lequel apparaissent justement des lignes, des contours, mais aussi des mots, « qu'il ne pourrait être considéré qu'un signe consistant en des motifs bidimensionnels décoratifs se confond avec la forme du produit lorsque ce signe est apposé sur des produits, tels qu'un tissu ou un papier, dont la forme se distingue desdits motifs décoratifs ».
C. P.
Incidence d'un « disclaimer ». L'arrêt du 12 juin 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne vient se prononcer sur la légalité d'une disposition suédoise permettant aux déposants d'avoir recours à une déclaration de renonciation – « disclaimer » – ayant pour effet de limiter la protection au titre du droit exclusif d'un élément d'une marque considéré comme non distinctif.
En 2007, une société suédoise – Norrtelje Brenneri Aktiebolag – a obtenu l'enregistrement d'un signe comprenant le vocable RöslagsPunsch pour des produits relevant de la classe 33, à savoir des boissons alcoolisées. Cet enregistrement a fait l'objet d'une déclaration de renonciation précisant qu'il ne conférait pas un droit exclusif sur le vocable en question en raison de son caractère descriptif pour les produits désignés, le terme Roslags renvoyant à une région Suédoise et le terme Punsch décrivant l'un des produits couvert par la demande d'enregistrement. En 2015, M. Hansson demande l'enregistrement du signe verbal Roslagsöl pour des produits similaires à la marque antérieure – des boissons non alcoolisées et des bières. Cette demande fut refusée par l'office suédois au motif qu'il existerait un risque de confusion entre ce signe et la marque antérieure susmentionnée.
L'affaire fut ensuite portée devant la Cour d’appel de Stockholm. Cette dernière décida d'interroger la Cour de justice sur la portée d'un « disclaimer » dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, afin de déterminer si une déclaration de renonciation a pour effet d'exclure un élément d'une marque complexe de l'analyse des facteurs pertinents pour établir l'existence d'un risque de confusion ou d'attribuer à un tel élément, d'emblée et de manière permanente, une importance limitée dans cette analyse.
Pour répondre à cette question, la Cour de justice rappelle que la première directive « Marques » laissait les États membres souverains quant aux questions de procédure. Dès lors, rien ne les empêche, a priori, d'introduire dans leur droit national des dispositions prévoyant le recours aux « disclaimers ». Cette souveraineté n'est toutefois pas totale et doit être appréciée à la lumière des objectifs poursuivis par la directive Marques, à savoir, notamment, que l'acquisition et la conservation du droit sur une marque doivent être subordonnées aux mêmes conditions dans tous les États membres. Les juges continuent en indiquant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Il convient ainsi de prendre en considération la similitude des signes en conflit et de les comparer sur la base de l'impression d'ensemble qu'ils produisent, au regard, notamment, des éléments distinctifs et dominants. De même, la distinctivité du signe antérieur, qui détermine l'étendue de sa protection, doit être appréciée par rapport au signe pris dans son ensemble, c'est-à-dire à la lumière de tous les éléments composant le signe. Ainsi, l'exclusion d'un élément du signe considéré comme non distinctif par une déclaration de renonciation reviendrait à vicier l'appréciation de la similitude et, plus généralement, l'appréciation globale du risque de confusion. Un tel dispositif serait incompatible avec les préceptes dégagés par la Cour de justice et, partant, avec la directive 2008/95/CE.
Pour les mêmes raisons, une telle déclaration de renonciation ne peut avoir pour effet de reconnaître, d'emblée et de manière générale, un caractère limité à un élément d'un signe considéré comme peu ou non distinctif aux fins de l'analyse de la similitude des signes en conflit.
C. P.
B - Exercice du droit de marque
Santé publique. La mise en balance des intérêts est fréquemment opérée par les juges et s'avère parfois délicate. Ces dernières années, l'industrie du tabac a souffert, à ce titre, de tourments judiciaires, notamment face aux considérations de santé publique. C'est dans ce contexte particulier que la directive 2014/40/UE, dite directive « Tabac », a été adoptée. Ce texte poursuit un double objectif : d'une part, le bon fonctionnement du marché de l'Union européenne des produits de tabac ou produits connexes et, d'autre part, la protection de la santé – tout particulièrement du jeune public.
Si, par le passé, la Cour de justice a eu l'occasion d'apporter des éclaircissements quant à l'interprétation des dispositions de cette directive, des zones d'ombre subsistaient. Ainsi, par un arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de justice s'est prononcée sur la validité et l'interprétation des articles 7 et 13 de la directive 2014/40/UE portant respectivement sur la réglementation des ingrédients des produits de tabac et leur présentation. Interrogée en premier lieu sur des questions de droit primaire de l'Union européenne, la Cour retient que les dispositions de la directive portant sur les produits de tabac aromatisé ne violent ni le principe de sécurité juridique, ni le principe d'égalité de traitement, ni le principe de proportionnalité.
Il est ensuite demandé à la Cour – et c'est ce qui attire plus particulièrement notre attention – de déterminer si les restrictions apportées à l'exploitation des marques de tabac constituent ou non une expropriation disproportionnée au sens de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit de propriété et visant expressément les droits de propriété intellectuelle. La Cour de justice se livre ainsi à un contrôle de proportionnalité avec, d'un côté, le droit de propriété établi au rang de prérogative sacro-sainte et, de l'autre, l'intérêt général visant à garantir un niveau élevé de santé publique. Au titre d'une opération de balance des intérêts, l'arrêt retient que « le droit de propriété n'apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société ». Or, la vente de tabac aromatisé constituerait une « invitation » à la consommation, en ce qu'il inciterait les jeunes à se tourner vers des produits facilitant l'initiation à la consommation de tabac. La marque remplirait, dès lors, une fonction sociale devant s'incliner face aux considérations de santé, sans pour autant que soit constatée une expropriation des titulaires de droits. Il est souligné que les restrictions sur ces produits de tabac ne portent que sur leur utilisation, laissant aux opérateurs la « liberté de les exploiter de toute autre manière, comme notamment au moyen de la vente en gros ». Le droit de propriété pris lato sensu – droit privé par essence – se voit uniquement limité au regard de l'intérêt général et, selon la Cour, ne se voit pas privé de sa pleine substance.
La solution vient ainsi verrouiller le système de la directive 2014/40/UE et n'est pas sans rappeler celle dégagée en 2016 dans l'affaire Philip Morris, qui opérait une balance des intérêts entre liberté d'expression, liberté d'entreprise, droits de propriété intellectuelle et santé publique – cette dernière supplantant pareillement des droits fondamentaux pourtant bien ancrés.
M.-S. B.
Atteinte au droit de marque. L'arrêt du 11 avril 2019 permet d'envisager la question de la mise en œuvre d'un droit de marque portant sur un signe utilisé comme label de test. Les faits peuvent être résumés de la manière suivante : la société ÖKO-Test Verlag réalise des tests sur des produits et les publie à destination des consommateurs. Elle est à ce titre titulaire d'une marque de l'Union européenne et d'une marque nationale allemande, enregistrées toutes deux pour des services de tests et de conseil aux consommateurs. Ces deux marques représentent un label destiné à présenter le résultat des tests auxquels ont été soumis des produits. Les fabricants des produits testés avec succès peuvent ainsi apposer la marque en question sur leurs produits, en tant que label de test, sous réserve toutefois d'avoir conclu un contrat de licence avec la société ÖKO-Test Verlag. La société Dr Liebe avait bénéficié d'un tel contrat en 2005 pour l'un des produits qu'elle commercialisait. Elle a toutefois poursuivi l'utilisation du label bien au-delà du terme de la licence, et ce, sans autorisation. La société ÖKO-Test Verlag introduisit une action en contrefaçon contre la société Dr Liebe, qui contesta avoir utilisé le label en tant que marque. Face aux doutes entourant la nature de l'usage du signe effectué par cet opérateur économique, la juridiction de renvoi décida d'interroger la Cour de justice afin de déterminer si le droit de marque pouvait être mis en œuvre lorsque l'usage litigieux porte sur un signe, apposé comme label de test sur des produits.
La Cour de justice se prononce dans un premier temps sur l'application des articles 9, § 1 a) et b), du règlement sur la marque de l'Union européenne et 5, § 1 a) et b), de la directive 2008/95/CE, c'est-à-dire sur les atteintes au droit de marque en cas de double identité et de similitude. Les juges relèvent que l'expression « pour des produits et des services », visée par ces dispositions, renvoie aux produits et services du tiers, à savoir ceux qu'il cherche à désigner en faisant usage d'un signe litigieux identique ou similaire. Le droit de marque ne peut pas être mis en œuvre lorsque le tiers utilise un signe identique ou similaire à la marque du titulaire afin de renvoyer aux produits ou services de ce dernier. La Cour de justice rappelle toutefois qu'une exception est envisageable. Il s'agit de l'hypothèse où le tiers utilise le signe du titulaire afin d'identifier ses produits lorsqu'ils constituent l'objet même des services fournis par ce tiers. Au regard de ces éléments, le titulaire d'une marque utilisée par un tiers comme label de test ne peut donc pas se prévaloir de son droit exclusif. Il pourra toutefois recourir aux dispositions relatives à la protection spécifique des marques renommées, la Cour de justice précisant que, pour leur mise en œuvre, il importe simplement de démontrer que la marque antérieure est connue par une partie significative du public pertinent. Une fois la renommée établie, il incombera à la juridiction de renvoi d'apprécier ensuite l'atteinte à celle-ci.
La solution emporte difficilement l'assentiment sur ce point. En effet, une question reste en suspens : est-il fait un usage à titre de marque d'un signe utilisé en tant que label de test par les fabricants des produits testés ? À cette question, essentielle pour mettre en œuvre la protection conférée par le droit de marque, la Cour fait le choix de ne malheureusement pas y répondre.
R. S.
Dégénérescence de la marque. Un signe enregistré peut devenir ou retourner à l'état de res nullius lorsque, cumulativement, il devient la désignation usuelle des produits ou services qu'il désigne et que cette dégénérescence est imputable à l'action ou, plutôt, à l'inaction de son titulaire. L'appréciation de la dégénérescence implique de tenir compte, en sus de la perception de l'utilisateur final, de celle des professionnels du secteur dès lors que les spécificités du marché des produits et services en cause l'exigent, comme le rappelle, à bon escient, l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 8 novembre 2018. L'affaire concernait la marque verbale de l'Union européenne Spinning, déposée en 1996 et enregistrée en 2000, afin de désigner notamment les produits et services « Équipements d'exercice », « Entrainement physique », dont la validité était contestée dans le cadre d'une action en déchéance fondée sur l'article 51, § 1 b), du règlement (CE) no 207/2009 – aujourd'hui article 58, § 1 b). La dégénérescence fut constatée et, partant, la déchéance prononcée par la division d'annulation, puis la chambre de recours, au motif que le signe litigieux serait devenu, en République Tchèque, la désignation usuelle d'un type d'« entraînement physique » et des « équipements d'exercice » utilisés pour cet entraînement. Le titulaire de la marque, contestant cette décision, a introduit un recours en annulation auprès du Tribunal de l'Union européenne. Dans un premier temps, il fait valoir que l'analyse de la dégénérescence du signe litigieux ne peut être limitée à un seul État membre. Les juges rappellent à cet égard que « le caractère unitaire de la marque de l'Union européenne constitue le principe juridique de base qui sous-tend l'ensemble du règlement (CE) no 207/2009 ». Dès lors, le constat de la transformation d'une marque en une désignation usuelle dans un seul État membre suffit pour que la déchéance des droits de son titulaire soit prononcée pour l'ensemble de l'Union.
Dans un second temps, la société requérante reproche à la chambre de recours d'avoir exclu la prise en compte de la perception des professionnels du secteur. Le tribunal se montre plus sensible à cet argument et retient que le public professionnel, à savoir les exploitants de salles de sport, d'établissements sportifs et de centres de réhabilitation, aurait dû être pris en considération afin d'apprécier la généricité de la marque litigieuse. En effet, lorsque la nature du produit ou du service implique l'intervention d'intermédiaires, lesquels ont un « rôle central » ou « une influence déterminante » dans l'acte d'achat, l'appréciation de la dégénérescence d'une marque ne peut être circonscrite à la perception de l'utilisateur final. Or, le tribunal relève ici que le public pertinent était constitué des utilisateurs finals, mais surtout de professionnels, ces derniers représentant 95 % des achats directs de vélos d'intérieur. La chambre de recours a, par conséquent, commis une erreur en excluant de son analyse la perception de ce public professionnel, justifiant que sa décision soit annulée.
M. S.
Compétence des tribunaux sur la marque de l'Union européenne. Par un arrêt du 5 septembre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne apporte des précisions – importantes – quant à la portée de l'article 97, § 5, du règlement sur la marque communautaire relatif à la compétence juridictionnelle. La juridiction britannique de renvoi souhaitait savoir si le titulaire d'une marque européenne pouvait intenter une action en contrefaçon devant un tribunal de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs et des professionnels visés par des publicités ou offres à la vente – le Royaume-Uni –, nonobstant le fait que le tiers ait décidé de celles-ci dans un autre État membre – l'Espagne.
Pour répondre à cette question, la Cour de justice consacre, dans un premier temps, l'application du Règlement sur la marque communautaire, lex specialis, et évince le règlement (UE) no 1215/2012 en le qualifiant de lex generalis. Elle rappelle ensuite le caractère alternatif et non-cumulatif des fors visés aux §§ 1er et 5 de l'article 97. Les actions en matière de contrefaçon de marque de l'Union européenne peuvent ainsi être portées soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis. Le choix susceptible d'être opéré par le titulaire n'est pas sans conséquence quant à l'étendue du champ de compétence territoriale. En effet, lorsque l'action en contrefaçon est fondée sur le § 1er de l'article 97, elle vise potentiellement tous les faits de contrefaçon commis sur l'ensemble du territoire de l'Union, le titulaire pouvant se prévaloir d'injonctions paneuropéennes. À l'inverse, lorsque l'action est fondée sur le § 5, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dont relève le tribunal saisi.
Dans un second temps, la Cour renvoie à sa jurisprudence Coty selon laquelle les termes « territoire [de l'État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » renvoient à un comportement actif de l'auteur de la contrefaçon alléguée. Dès lors, le tribunal saisi doit s'assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur le territoire de l'État membre dont il relève. C'est à l'arrêt L'Oréal du 12 juillet 2011 qu'elle se réfère ensuite, décision dans laquelle elle avait considéré que des actes tels que des publicités et des offres à la vente sont considérés comme ayant été commis sur le territoire où se trouvent les consommateurs ou les professionnels auxquels les publicités et offres sont destinées, et ce, nonobstant le fait que le défendeur soit établi sur un autre territoire, que le serveur du réseau électronique qu'il utilise se trouve sur un autre territoire ou bien encore que les produits faisant l'objet des publicités et des offres se situent dans un autre territoire.
La Cour adopte ensuite une approche réaliste et pratique. Elle fait valoir que la compétence ne peut valablement se limiter au lieu où le défendeur a pris les décisions et mesures techniques de déclenchement de l'affichage sur internet en ce qu'il priverait le for alternatif de son effet utile, sans oublier que ce lieu peut s'avérer excessivement difficile à déterminer. Elle rappelle aussi la position privilégiée dont bénéficie le juge de l'État membre de résidence des consommateurs et professionnels visés, bien plus apte à évaluer l'existence de la contrefaçon alléguée. Les juges concluent ainsi à la compétence du tribunal des marques de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par les publicités et offres à la vente dénoncées comme contrefaisantes. Ce faisant, les juges consacrent, pour la marque de l'Union européenne, le critère de la focalisation au détriment de celui de l'accessibilité.
C.dM-E.
II - Actualité française du droit des marques
A - Existence du droit de marque
Dépôt frauduleux. Au titre de l'adage fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu'il est réalisé en vue de priver des concurrents d'un signe nécessaire à l'exercice de leurs activités. En conséquence, la fraude suppose, non pas l'existence de droits antérieurs méconnus par le déposant, mais la preuve qu'il aurait sciemment méconnus d'autres intérêts. Cette appréciation de la fraude en droit des marques a été réitérée par la Cour de cassation dans un arrêt Scootlib en date du 12 décembre 2018.
En février 2007, la Ville de Paris dépose les marques Velib' et Autolib'. En octobre de la même année, la société luxembourgeoise Olky International dépose la marque Scootlib afin de désigner notamment un service de location de véhicules. En 2011, la Ville de Paris fait enregistrer la marque Scootlib'Paris. Quelques années plus tard, celle-ci assigne Olky International en nullité de la marque Scootlib pour fraude, sans succès toutefois, la Cour d’appel de Paris refusant de faire droit à ses prétentions. La Cour de cassation vient ici confirmer cette analyse. La chambre commerciale estime en effet que c'est à bon droit que les juges du fond ont considéré que la Ville de Paris n'avait pas prouvé que la société luxembourgeoise Olky International avait pour intention, en déposant la marque Scootlib, peu après l'enregistrement des marques Velib' et Autolib', de priver la Ville de Paris du signe litigieux et de profiter de sa renommée. D'une part, l'existence de ces droits antérieurs est indifférente. D'autre part, il n'est pas caractérisé que la société Olky International avait connaissance du projet de la ville de Paris à la date du dépôt de la marque litigieuse, d'autant que la communication de cette dernière au moment du dépôt de la marque Velib' révélait une volonté politique de désengorger Paris de ses véhicules à moteur.
C.dM-E.
B - Exercice du droit de marque
Usage sous une forme modifiée. La protection offerte par le droit des marques ne doit pas permettre au titulaire d'user de ses prérogatives à l'encontre de tiers dès lors que la marque a perdu sa raison d'être commerciale. C'est pourquoi le titulaire qui n'exploite pas sa marque encourt la déchéance de ses droits s'il ne rapporte pas la preuve d'un usage sérieux de sa marque. Le titulaire est cependant autorisé à se prévaloir de l'usage de sa marque sous une forme modifiée, sous réserve que le caractère distinctif ne s'en trouve pas altéré. Ce tempérament, envisagé à l'article L. 714-5, alinéa 2 b), permet aux titulaires de faire évoluer leurs marques, sans risquer la déchéance et sans avoir à déposer de nouvelles marques. La Cour de cassation a fait application de cette règle dans un arrêt du 12 décembre 2018, dans une affaire opposant la société Toutabo à la société Lekiosque.fr.
Suite à une opposition de la société Toutabo (ci-après « Toutabo ») contre les demandes d'enregistrement de marques de l'Union européenne de la société Lekiosque.fr (ci-après Lekiosque.fr), cette dernière a assigné Toutabo afin de demander la déchéance de sa marque française MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET, enregistrée le 29 mai 2006. Les juges du fond refusèrent de faire droit à cette demande pour les services d'abonnement et de distribution de journaux, au motif que l'usage de cette marque sous une forme modifiée constitue un usage sérieux faisant échec à la déchéance des droits du titulaire. En effet, le fait que l'usage de la marque porte principalement sur le signe monkiosque.fr n'emporte pas de conséquences, dès lors que le caractère distinctif est issu de la partie monkiosque et non de la double répétition du terme monkiosque, ni des suffixes « .fr.net », qui par essence sont dépourvus de caractère distinctif. Les juges relevèrent également que la société Toutabo ne se prévalait pas d'une famille de marques déposée, mais d'un usage de cette marque sous différentes formes, empêchant ainsi de faire application des arrêts Bainbridge et Rintisch. La Cour de cassation vient ici confirmer cette analyse, en considérant que le moyen invoqué n'est pas de nature à entraîner la cassation.
M. S.
Reprise de l'usage sérieux. En vertu de l'article L. 714-5, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque encourt la déchéance de ses droits lorsqu'il n'a pas fait usage de son signe pour les produits et services visés dans l'enregistrement, et ce pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance ne sera toutefois pas prononcée si le titulaire rapporte la preuve qu'il a débuté ou repris un usage après l'écoulement de ce délai. Il convient donc de déterminer si l'usage peut être qualifié de sérieux dans les cinq ans qui précèdent la demande en déchéance. C'est ce que vient opportunément rappeler la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 21 décembre 2018, qui vient clore la saga judiciaire Abercrombie & Fitch. Sans qu'il soit utile de rentrer dans les détails, la première cour d'appel de renvoi avait prononcé la déchéance de la marque Abercrombie & Fitch, enregistrée en 1989 pour désigner des produits de la classe 25, faute pour son titulaire d'avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux de celle-ci avant 1994. Cette analyse fut censurée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2016. En effet, la demande en déchéance ayant été portée devant les juges du fond en 2007, la cour d'appel aurait dû tenir compte de l'usage fait de la marque à partir de 2002. La seconde cour de renvoi fait ainsi preuve d'une plus grande rigueur en notant que les différents éléments de preuve rapportés permettent de démontrer l'existence d'un usage sérieux de la marque litigieuse dans les cinq années précédant la demande en déchéance, justifiant de ne pas la constater.
C.dM-E.
Usage à titre de marque. La mise en œuvre du droit de marque implique la réunion de plusieurs conditions, dont, notamment, la démonstration que l'usage litigieux est fait à titre de marque et porte atteinte à la fonction essentielle de la marque. L'arrêt rendu le 23 janvier 2019 fait application de ce principe à propos d'une marque utilisée par un tiers comme référence d'un modèle de meuble.
En l'espèce, la société Caravane, titulaire de nombreuses marques éponymes, commercialise des articles d'ameublement et, tout particulièrement, des canapés. Constatant que la société Roche Bobois commercialise des produits identiques sous l'appellation Karawan, elle assigne cette dernière en contrefaçon de marque. L'arrêt d'appel ayant retenu les griefs de contrefaçon, la défenderesse se pourvoit en cassation. La société Roche Bobois considère en effet qu'elle ne faisait pas usage du signe litigieux à titre de marque, mais comme une simple référence pour identifier un modèle de canapé, la pratique étant usuelle pour de tels produits. Le consommateur moyen comprendrait que la référence d'un modèle est distincte de la marque de l'enseigne commercialisant les produits.
Ce raisonnement n'emporte pas la conviction de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi en affirmant que l'usage du signe litigieux est à même de remplir la fonction essentielle de marque et n'apparaît pas comme un simple indicateur de référencement. La Cour de cassation renvoie ainsi à l'analyse in concreto opérée par les juges du fond qui retinrent que le signe litigieux « figure en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des produits (…) en outre reproduit sur les présentations et sur les catalogues diffusés au public et que, sur le moteur de recherches Google, les mots-clés “canapés” et “Karawan” dirigent immédiatement vers la gamme de produits litigieux » venant de la sorte éclipser la marque ombrelle. La volonté d'individualisation par la société de la gamme de meubles s'avère suffisante pour constater qu'il est fait usage à titre de marque du signe Karawan et, partant, mettre en œuvre le droit de marque.
M.-S. B.
C - Procédure
Saisie-contrefaçon. En matière de contrefaçon, les litiges techniques nécessitent souvent l'intervention d'experts, d'hommes du métier pour éclairer juges et parties sur certains faits et établir la preuve de la contrefaçon. C'est dans ce cadre que le conseil en propriété industrielle intervient aux côtés de l'huissier, en tant qu'expert, au cours des procédures de saisie-contrefaçon autorisées sur ordonnance à la requête de la partie demanderesse. Dans un important arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation est venue réaffirmer l'indépendance du conseil en propriété industrielle du titulaire des droits justifiant la saisie-contrefaçon et le principe selon lequel il peut assister l'huissier, en tant qu'expert, dans sa mission.
En l'espèce, deux conseils avaient été désignés par le demandeur à une action en contrefaçon pour assister un huissier lors de la saisie-contrefaçon de machines reproduisant son brevet, alors que ceux-ci avaient été mandatés par ce même demandeur pour la réalisation d'un rapport d'expertise privée sur lequel il avait fondé son action. Pour la Cour de cassation, cette double intervention, d'abord en qualité d'experts privés, puis en qualité d'experts assistant l'huissier, ne soulève aucun doute quant à leur impartialité : les conseils en propriété industrielle exerçant leur profession avec dignité, conscience, indépendance et probité. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que la mission des conseils en propriété industrielle n'est « pas soumise au devoir d'impartialité » et ne constitue « pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile ». En réaffirmant ces principes, la Cour maintient la position qu'elle adopta en 2005. La solution, saluée par l'ensemble de la profession des conseils en propriété industrielle, dont la Compagnie Nationale était intervenante volontaire à l'instance, permet aux conseils habituels des titulaires de titres de continuer d'assister les huissiers dans le cadre de saisies-contrefaçons demandées par leurs clients.
R. S.



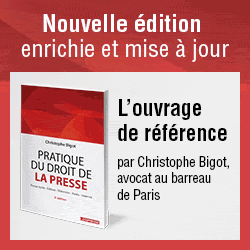
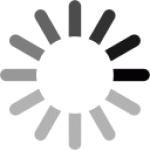
 S'abonner à Legipresse
S'abonner à Legipresse Feuilleter le dernier numéro
Feuilleter le dernier numéro