Pour participer au débat !
Est-il possible de se faire totalement oublier sur internet ?
Le «droit à l’oubli numérique», consacré en mai 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) (1), a très vite été rebaptisé «droit au déréférencement». Mais, n’est-il pas beaucoup plus que ça? De là à contraindre un éditeur à retirer un contenu ?
L'oubli par le déférencement d'un lien
Par un arrêt du 13 mai 2014 (2), la CJUE a reconnu, sur le fondement du droit d’opposition (tel que visé dans la directive 95/46/CE), qu’une personne physique peut, en s’appuyant sur un motif légitime, exiger qu’une information relative à sa personne ne soit plus liée à son nom par une liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir dudit nom. Une condition a toutefois était posée: il ne faut pas que le public ait «un intérêt prépondérant(…)à avoir, dans le cadre d’une telle recherche, accès à ces informations».
Cette décision, qui consacre ainsi le droit à l’oubli numérique, a été particulièrement remarquée. D’ailleurs, la réaction de Google ne s’est pas fait attendre. Dans les semaines qui ont suivi la publication de cette décision, le célèbre moteur de recherche avait mis en ligne, sur son site internet, un formulaire intitulé «Demande de suppression de résultat de recherche au titre de la législation européenne en matière de protection des données». Bien entendu, Google n’a pas répondu et ne répond pas positivement à toutes les demandes qui lui sont adressées… C’est pourquoi de nombreuses plaintes aient été déposées par les internautes auprès des autorités nationales de protection des données.
C’est dans ce contexte que le groupe de travail de l’article 29 (ci-après le «G29») (3) a décidé d’élaborer des lignes directrices ayant pour objet de permettre aux autorités nationales de protection des données de traiter de manière coordonnée les plaintes qui leurs sont soumises. Le 26 novembre 2014, le G29 a ainsi, non seulement, pris une position concernant l’interprétation de l’arrêt de la CJUE du 13 mai 2014, mais a aussi adopté des critères communs dans le cadre de l’instruction desdites plaintes (4).
Dans certaines situations, le rejet de la demande de déréférencement par Google ne se traduit pas par une plainte devant la CNIL. La personne concernée décide, en effet, d’assigner en référé Google aux fins d’obtenir le déréférencement souhaité. C’est ce qui s’est produit dans une affaire dans laquelle, une internaute avait constaté que la formulation d’une requête portant sur son nom dans le moteur de recherche Google faisait ressortir en première position, parmi les résultats obtenus, un lien vers un article du Parisien daté de 2006, intitulé «Ils ont escroqués plus d’une vingtaine de sociétés». Elle avait alors décidé d’assigner Google Inc. au visa notamment de l’article 809 du Code de procédure civile et de l’article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et ce, afin que le Président du Tribunal de grande instance de Paris ordonne, sous astreinte, la désindexation du lien litigieux. Il s’agissait alors, pour le président du tribunal, de déterminer si la présence du lien litigieux pouvait s’analyser comme un «trouble manifestement illicite». En effet, comme indiqué supra, la demande avait été faite notamment sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, selon lequel: «Le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». Il est à préciser que la demanderesse prétendait bénéficier, en application de l’article 38 de la loi n°78-17, du «droit de s’opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement». En d’autres termes, la demanderesse entendait démontrer qu’elle avait des «motifs légitimes» à s’opposer au traitement en cause réalisé par Google Inc. (à savoir le référencement de l’article faisant état de sa condamnation pénale). En conséquence, elle soutenait que la présence du lien litigieux caractériserait un «trouble manifestement illicite», justifiant ainsi sa suppression. Le juge des référés a considéré que les «motifs» de la demanderesse caractérisaient des «raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur le droit d’expression et d’information» et a, en conséquence, fait droit à sa demande. En effet: «(…)eu égard à la nature des données à caractère personnel en cause, s’agissant de l’information publiée courant 2006 relative à une condamnation pénale prononcée à l’encontre de Mme M. soutenant que l’accès aux données en cause par simple interrogation à partir de ses nom et prénom via le moteur de recherche de Google par tout tiers nuit à sa recherche d’emploi; au temps écoulé, s’agissant d’une condamnation prononcée il y a plus de huit ans, et compte tenu de l’absence au jour des débats de mention de cette condamnation sur le bulletin n°3 du casier judiciaire de la demanderesse, dont le contenu est déterminé par la loi fixant en France les conditions dans lesquelles les tiers peuvent prendre connaissance de l’état pénal des personnes, Mme M justifie de raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur le droit à l’information» (5). Ainsi, selon cette ordonnance, la demanderesse avait des raisons légitimes au déréférencement, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une information relative à une condamnation pénale, prononcée il y a plus de huit ans et dont la mention n’apparaissait pas sur le bulletin n°3. Il semble donc que le juge des référés ait considéré que, puisque le juge pénal n’avait pas estimé utile de rendre l’information concernant cette condamnation accessible à tous, alors il n’y a pas lieu de maintenir un tel référencement puisque celui-ci a justement pour effet de rendre cette information (trop) facilement accessible.
Dans une affaire plus récente, le Président du Tribunal de grande instance a, en reprenant le même raisonnement que celui susvisé, enjoint à Google Inc de supprimer le lien vers le site sur lequel était publié un article intitulé «Scandal Mr X. (…) impliqué dans une affaire sexuelle envers mineure» (6). Constatant, d’une part, qu’un tel contenu portait gravement atteinte à la réputation du requérant, d’autre part, que ce contenu relevait d’avantage d’une «vindicte personnelle» de son auteur contre le requérant que d’une volonté d’informer le public et, enfin, que le requérant n’avait jamais fait l’objet d’aucune condamnation pour les faits dénoncés dans le contenu litigieux, le président a fait droit à la demande de déréférencement.
L'oubli par la suppression d'un contenu
Si le «droit à l’oubli numérique», consacré en mai 2014 par la CJUE a très vite été rebaptisé «droit au déréférencement», c’est tout simplement parce qu’il n’est invoqué qu’à l’encontre des moteurs de recherche et ce, en vue d’obtenir le déréférencement d’un lien. Mais, il ne faut pas oublier que ce «droit à l’oubli numérique» a été consacré sur le fondement de l’article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, selon lequel toute personne dont les données sont traitées a le droit, pour un motif légitime, de s’opposer que ses données fassent l’objet d’un traitement. Par conséquent, il est légitime de s’interroger sur la possibilité d’invoquer ou non ce droit dans un contexte dans lequel le mis en cause ne serait pas un moteur de recherche, mais l’éditeur du site internet sur lequel le contenu serait publié. Et le résultat serait bien plus spectaculaire qu’un simple déréférencement: le retrait pur et simple du contenu litigieux. Sur ce fondement, il serait donc possible d’obtenir la suppression d’un contenu et ce, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le contenu est illicite (atteinte à la vie privée, diffamation, injure, etc.).
En témoigne cette décision rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 23 mars 2015, aux termes de laquelle si la demande de retrait du contenu a été rejetée, ce n’est pas parce qu’elle aurait été mal dirigée (car dirigée contre l’éditeur), mais parce que le juge a considéré qu’il n’y avait pas, dans cette espèce, de trouble manifestement illicite (7). En effet, le président du tribunal a retenu que «le traitement des données litigieuses[était]manifestement nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime de l'éditeur de l'organe de presse »et qu'« aucun abus à la liberté de la presse telle que réglementée par la loi du 29 juillet 1881 qui en fixe les limite n'est établi». En effet, selon lui, le traitement en question, «en ce que sont rapportés l'âge et la profession de l'intéressé et le fait qu'il ait été impliqué dans une procédure pénale, a été réalisée par l'éditeur du journal d'information 20minutes publié sur le site internet www.20minutes.fr, à la seule fin de compléter l'information parue en 2011, en précisant que la procédure engagée s'est terminée par une décision de non-lieu». Et le président d’ajouter : «si l'article visait ces mêmes éléments, c'est d'évidence dans la relation qui était faite d'une procédure pénale - enquête et instruction - répondant à un intérêt légitime tant en ce que l'information portant sur le fonctionnement de la justice et le traitement des affaires d'atteintes graves aux personnes qu'en ce qu'elle visait une personne exerçant une profession faisant appel au public et encadrant une activité proposée notamment à des enfants». Cette ordonnance démontre bien que, sur le fondement de l'article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, il est parfaitement possible de demander et, le cas échéant, d'obtenir la condamnation d'un éditeur à la suppression d'un contenu qu'il a publié, contenu qui, sans être illicite, porterait atteinte à la réputation du requérant…
Toutefois, on comprend aussi à la lecture d’un arrêt récent de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation que si le bien-fondé d’une telle démarche devrait dépendre de la faculté de son auteur à démontrer un motif légitime (comme par exemple le fait que le contenu porterait sur des informations, qui sans pour autant être illicites, seraient inexactes, périmées, sensibles ou encore excessives par rapport au but poursuivi), il lui appartiendrait aussi et surtout de démontrer, lorsqu’il s’adresse à un éditeur, que cette démarche ne porte pas atteinte abusivement à la liberté d’expression. Ainsi, dans cette affaire dans laquelle il était seulement demandé à un organe de presse – Les Echos – de retirer les noms et prénoms des requérants de son moteur de recherche, la haute juridiction a mis en exergue, pour justifier la décision de rejet de la Cour d’appel, le fait qu’une telle demande «excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse» (8). Ainsi et alors qu’il n’était même pas demandé à l’éditeur la suppression de l’article litigieux, les juridictions ont rejeté malgré tout la demande de « déréférencement » en se prévalant de la liberté d’expression. A suivre…
(1) CJUE, 13 mai 2014, C-131/12.
(2) CJUE, 13 mai 2014, C-131/12.
(3) Groupe de travail de l’article 29 de la directive 95/46/CE, composé d’un représentant de l’autorité contrôle de chaque Etat membre.
(4) CNIL, Droit au déréférencement – Les critères communs utilisés pour l’examen des plaintes.
(5) TGI, Ord. réf., 19 décembre 2014, Marie-France F. / Google France et Google Inc.
(6) TGI, Ord. réf., 13 mai 2016, Monsieur X. / Google France et Google Inc.
(7) TGI, Ord. réf., 23 mars 2015, M.P. / 20 Minutes France.
(8) Cass. civ., 1ère, 12 mai 2016, n° 15-17729.




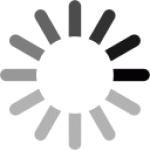
 S'abonner à Legipresse
S'abonner à Legipresse Feuilleter le dernier numéro
Feuilleter le dernier numéro